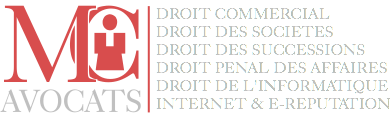2014

Loi sur la consommation : la réforme des loteries publicitaires
http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/185421-loi-sur-la-consommation-la-reforme-annoncee-des-loteries-publicitaires.html Read More
2014

Un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur.
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur.
Une telle injonction et son exécution doivent toutefois assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux concernés.
La Cour estime dès lors que les droits fondamentaux concernés ne s’opposent pas à une telle injonction, à la double condition que les mesures prises par le fournisseur d’accès ne privent pas inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les
utilisateurs de consulter les objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
La Cour précise que les internautes ainsi d’ailleurs que le fournisseur d’accès à Internet doivent pouvoir faire valoir leurs droits devant le juge. Cette thèse était d’ailleurs déjà validée par la Cour d’appel de Paris, à l’initiative des avocats notamment de FREE, ORANGE, BOUYGUES et SFR.
Il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier si les conditions sus-citées sont bien remplies.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 mars 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Société de l’information – Directive 2001/29/CE –Site Internet mettant des œuvres cinématographiques à la disposition du public sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur – Article 8, paragraphe 3 – Notion d’ʻintermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisinʼ – Fournisseur d’accès à Internet – Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet – Mise en balance des droits fondamentaux»
Dans l’affaire C‑314/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 11 mai 2012, parvenue à la Cour le 29 juin 2012, dans la procédure
UPC Telekabel Wien GmbH
contre
Constantin Film Verleih GmbH,
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2013,
considérant les observations présentées:
– pour UPC Telekabel Wien GmbH, par Mes M. Bulgarini et T. Höhne, Rechtsanwälte,
– pour Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, par Mes A. Manak et N. Kraft, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans et C. Wissels, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. W. Bulst, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphes 1 et 2, sous b), et 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), ainsi que de certains droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UPC Telekabel Wien GmbH (ci-après «UPC Telekabel») à Constantin Film Verleih GmbH (ci-après «Constantin Film») et à Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ci-après «Wega») au sujet d’une demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de bloquer l’accès de ses clients à un site Internet mettant à la disposition du public certains des films de ces dernières sans leur consentement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9 et 59 de la directive 2001/29 énoncent:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. […] La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
[…]
(59) Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé. […] Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres.»
4 L’article 1er de ladite directive, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 1:
«La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.»
5 L’article 3 de la même directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», prévoit à son paragraphe 2:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement:
[…]
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;
[…]»
6 L’article 8 de la directive 2001/29, intitulé «Sanctions et voies de recours», indique à son paragraphe 3:
«Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.»
Le droit autrichien
7 L’article 18a, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiée par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-après l’«UrhG»), est libellé comme suit:
«L’auteur a le droit exclusif de mettre l’œuvre à la disposition du public, par fil ou sans fil, d’une manière qui permette à chacun d’y avoir accès de l’endroit et au moment de son choix.»
8 L’article 81, paragraphes 1 et 1a, de l’UrhG dispose:
«1. Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé ou qui redoute une telle violation peut engager une action en abstention. Le propriétaire d’une entreprise peut aussi être poursuivi en justice si la violation a été commise au cours de l’activité de son entreprise par l’un de ses employés ou par un mandataire ou si elle menace de l’être; l’article 81, paragraphe 1a, s’applique mutatis mutandis.
1a. Si l’auteur d’une telle atteinte ou la personne dont une telle atteinte est à craindre utilise à cette fin les services d’un intermédiaire, une action en abstention peut également être introduite contre ce dernier au titre du paragraphe 1. […]»
9 L’article 355, paragraphe 1, du code relatif aux procédures d’exécution dispose:
«La procédure d’exécution forcée à l’encontre de la personne tenue de cesser d’agir ou de tolérer un agissement prévoit que, pour chaque violation perpétrée après que l’obligation a acquis force exécutoire, le tribunal saisi de l’exécution, en accordant cette dernière, inflige, sur demande, une sanction pécuniaire. Pour chaque violation ultérieure, le tribunal saisi de l’exécution doit infliger, sur demande, une sanction pécuniaire supplémentaire ou une peine d’emprisonnement d’une durée totale d’un an maximum. […]»
10 Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle que, au stade de la procédure d’exécution forcée, le destinataire de l’interdiction peut faire valoir, pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat interdit.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Constantin Film et Wega, deux sociétés de production cinématographique, ayant constaté qu’un site Internet proposait, sans leur accord, soit de télécharger, soit de regarder en «streaming» certains des films qu’elles avaient produits, ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG, la délivrance d’une ordonnance enjoignant à UPC Telekabel, un fournisseur d’accès à Internet, de bloquer l’accès de ses clients au site Internet en cause, dans la mesure où ce site met à la disposition du public, sans leur consentement, des œuvres cinématographiques sur lesquelles elles détiennent un droit voisin du droit d’auteur.
12 Par ordonnance du 13 mai 2011, le Handelsgericht Wien (Autriche) a interdit à UPC Telekabel de fournir à ses clients l’accès au site Internet litigieux, cette interdiction devant être notamment réalisée en bloquant le nom de domaine et l’adresse IP («Internet Protocol») actuelle de ce site ainsi que toute autre adresse IP de ce dernier dont cette société pourrait avoir connaissance.
13 Au mois de juin 2011, le site Internet litigieux a cessé son activité à la suite d’une action des forces de police allemande à l’encontre de ses exploitants.
14 Par ordonnance du 27 octobre 2011, l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), en tant que juridiction d’appel, a partiellement réformé l’ordonnance de la juridiction de première instance en ce que celle-ci avait, à tort, spécifié les moyens qu’UPC Telekabel devait mettre en œuvre pour procéder au blocage du site Internet litigieux et ainsi exécuter l’ordonnance d’injonction. Pour parvenir à cette conclusion, l’Oberlandesgericht Wien a estimé que l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG doit être interprété à la lumière de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Puis, il a considéré que, en donnant accès à ses clients aux contenus mis en ligne illégalement, UPC Telekabel devait être considérée comme un intermédiaire dont les services étaient utilisés pour porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur de sorte que Constantin Film et Wega étaient en droit de demander à ce qu’une ordonnance soit prononcée contre cette société. Cependant, s’agissant de la protection du droit d’auteur, l’Oberlandesgericht Wien a estimé qu’UPC Telekabel pouvait uniquement se voir obligée, sous la forme d’une obligation de résultat, d’interdire à ses clients l’accès au site Internet litigieux, mais qu’elle devait rester libre de décider des moyens à mettre en œuvre.
15 UPC Telekabel a formé un pourvoi en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof (Autriche).
16 Au soutien de son pourvoi, UPC Telekabel fait notamment valoir que ses services ne pouvaient être considérés comme utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, car elle n’entretenait aucune relation commerciale avec les exploitants du site Internet litigieux et il n’est pas établi que ses propres clients ont agi de manière illégale. En tout état de cause, UPC Telekabel soutient que les différentes mesures de blocage susceptibles d’être mises en œuvre peuvent toutes être techniquement contournées et que certaines sont excessivement coûteuses.
17 Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 […] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui met des objets protégés à la disposition du public sur Internet sans l’autorisation du titulaire de droits [au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29] utilise les services du fournisseur d’accès [à Internet] des personnes qui consultent ces objets?
En cas de réponse négative à la première question:
2) Une reproduction effectuée pour un usage privé [au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire [au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29] ne sont-elles licites que si l’exemplaire servant à la reproduction a été reproduit, diffusé ou mis à la disposition du public en toute légalité?
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, c’est-à-dire dans le cas où une ordonnance judiciaire doit être rendue à l’encontre du fournisseur d’accès [à Internet] conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29:
3) Est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’interdire au fournisseur d’accès [à Internet] dans des termes très généraux (c’est-à-dire sans prescription de mesures concrètes) d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet dont l’intégralité ou une partie substantielle du contenu n’a pas été autorisée par le titulaire de droits, lorsque le fournisseur d’accès peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de cette interdiction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables?
En cas de réponse négative à la troisième question:
4) Est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’imposer à un fournisseur d’accès [à Internet] des mesures concrètes visant à rendre plus difficile à ses clients l’accès à un site Internet dont le contenu a été illégalement mis à disposition, lorsque ces mesures, qui requièrent des moyens non négligeables, peuvent facilement être contournées sans connaissances techniques spécifiques?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
18 À titre liminaire, il convient de relever que la circonstance selon laquelle le site Internet en cause au principal a cessé son activité ne rend pas les questions préjudicielles irrecevables.
19 En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, non encore publié au Recueil, point 34).
20 Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Aziz, précité, point 35).
21 Or, tel n’est pas le cas du litige au principal, puisqu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu du droit autrichien, la juridiction de renvoi doit rendre sa décision sur la base des faits tels qu’ils ont été exposés dans la décision de première instance, c’est-à-dire à un moment où le site Internet en cause au principal était encore accessible.
22 Il découle de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la première question
23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel serait à considérer comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l’affaire au principal, il est constant que des objets protégés ont été mis à la disposition des utilisateurs d’un site Internet sans le consentement des titulaires de droits évoqués audit article 3, paragraphe 2.
25 Vu que, selon cette disposition, les titulaires de droits jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire tout acte de mise à la disposition du public, il doit être constaté qu’un acte de mise à la disposition du public d’un objet protégé sur un site Internet effectué sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.
26 Pour remédier à une telle situation d’atteinte aux droits en question, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prévoit la possibilité, pour les titulaires de droits, de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à l’un de leurs droits.
27 En effet, ainsi que l’indique le considérant 59 de la directive 2001/29, dès lors que les services d’intermédiaires sont de plus en plus utilisés pour porter atteinte au droit d’auteur ou à des droits voisins, ces intermédiaires sont, dans de nombreux cas, les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.
28 En l’occurrence, le Handelsgericht Wien, puis l’Oberlandesgericht Wien ont enjoint à UPC Telekabel, fournisseur d’accès à Internet visé par l’injonction en cause au principal, de mettre fin à l’atteinte portée aux droits de Constantin Film et de Wega.
29 UPC Telekabel conteste toutefois pouvoir être qualifiée, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, d’intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
30 À cet égard, il découle du considérant 59 de la directive 2001/29 que le terme d’«intermédiaire», employé à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé.
31 Eu égard à l’objectif poursuivi par la directive 2001/29, tel qu’il ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, qui est de garantir aux titulaires de droits un niveau de protection élevé, la notion de contrefaçon ainsi employée doit être entendue comme incluant la situation d’un objet protégé mis sur Internet à la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits en question.
32 Par suite, vu que le fournisseur d’accès à Internet est un acteur obligé de toute transmission sur Internet d’une contrefaçon entre l’un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l’accès au réseau, il rend possible cette transmission (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, Rec. p. I‑1227, point 44), il y a lieu de considérer qu’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal, qui permet à ses clients d’accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers, est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
33 Une telle conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par la directive 2001/29. En effet, exclure les fournisseurs d’accès à Internet du champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 diminuerait substantiellement la protection des titulaires de droits, voulue par cette directive (voir, en ce sens, ordonnance LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, précitée, point 45).
34 Ladite conclusion ne saurait être remise en cause par l’objection selon laquelle, pour que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 soit applicable, il serait nécessaire qu’il existe un lien contractuel entre le fournisseur d’accès à Internet et la personne ayant commis l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
35 En effet, il ne ressort ni du libellé dudit article 8, paragraphe 3, ni d’aucune autre disposition de la directive 2001/29 qu’il serait exigé une relation particulière entre la personne qui porte atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin et l’intermédiaire. En outre, cette exigence ne saurait non plus être déduite des objectifs poursuivis par cette directive étant donné qu’admettre une telle exigence réduirait la protection juridique reconnue aux titulaires de droits en cause, alors que l’objectif de ladite directive, ainsi que cela ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, est précisément de leur garantir un niveau élevé de protection.
36 La conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 30 du présent arrêt n’est pas non plus infirmée par l’affirmation selon laquelle, pour obtenir que soit prononcée une injonction à l’encontre d’un fournisseur d’accès à Internet, les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin doivent démontrer que certains des clients dudit fournisseur consultent effectivement, sur le site Internet en cause, les objets protégés mis à la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits.
37 En effet, la directive 2001/29 exige que les mesures que les États membres ont l’obligation de prendre afin de se conformer à celle-ci aient pour objectifs non seulement de faire cesser les atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits voisins, mais également de les prévenir (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, Rec. p. I-11959, point 31, et du 16 février 2012, SABAM, C‑360/10, non encore publié au Recueil, point 29).
38 Or, un tel effet préventif suppose que les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin puissent agir sans devoir établir que les clients d’un fournisseur d’accès à Internet consultent effectivement les objets protégés mis à la disposition du public sans l’accord desdits titulaires.
39 Il en est d’autant plus ainsi que l’existence d’un acte de mise à disposition d’une œuvre au public suppose uniquement que ladite œuvre ait été mise à la disposition du public, sans qu’il soit déterminant que les personnes qui composent ce public aient ou non effectivement eu accès à cette œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I-11519, point 43).
40 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
Sur la deuxième question
41 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
42 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables.
43 À cet égard, ainsi que cela ressort du considérant 59 de la directive 2001/29, les modalités des injonctions que doivent prévoir les États membres en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national.
44 Cela étant, ces règles nationales, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent respecter les limitations découlant de la directive 2001/29 ainsi que des sources de droit auxquelles le considérant 3 de celle-ci fait référence (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 33 et jurisprudence citée).
45 Aux fins d’apprécier la conformité au droit de l’Union d’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il convient donc de tenir notamment compte des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, et ce conformément à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 41).
46 La Cour a déjà dit pour droit que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux États membres, lors de la transposition d’une directive, de veiller à se fonder sur une interprétation de celle-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables, protégés par l’ordre juridique de l’Union. Puis, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ladite directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, point 68).
47 En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, fait s’opposer, principalement, premièrement, les droits d’auteur et les droits voisins qui font partie du droit de propriété intellectuelle et sont dès lors protégés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, deuxièmement, la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès à Internet, en vertu de l’article 16 de la Charte, ainsi que, troisièmement, la liberté d’information des utilisateurs d’Internet, dont la protection est assurée par l’article 11 de la Charte.
48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.
52 D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité.
53 D’autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l’adoption de ladite injonction.
54 À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exécution qu’il a prises et avant qu’une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit.
55 Cela étant, lorsque le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures à adopter afin de s’y conformer, il doit veiller à respecter le droit fondamental des utilisateurs d’Internet à la liberté d’information.
56 À cet égard, les mesures qui sont adoptées par le fournisseur d’accès à Internet doivent être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à mettre fin à l’atteinte portée par un tiers au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d’accéder de façon licite à des informations s’en trouvent affectés. À défaut, l’ingérence dudit fournisseur dans la liberté d’information desdits utilisateurs s’avérerait injustifiée au regard de l’objectif poursuivi.
57 Les juridictions nationales doivent avoir la possibilité de vérifier que tel est le cas. Or, dans la situation d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que, si le fournisseur d’accès à Internet adopte des mesures qui lui permettent de réaliser l’interdiction prescrite, les juridictions nationales n’auront pas la possibilité d’effectuer un tel contrôle au stade de la procédure d’exécution, faute de contestation à ce sujet. Par suite, pour que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union ne s’opposent pas à l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il est nécessaire que les règles nationales de procédure prévoient la possibilité pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d’exécution prises par le fournisseur d’accès à Internet.
58 En ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle, il doit d’emblée être relevé qu’il n’est pas exclu que l’exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, n’aboutisse pas à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle des personnes intéressées.
59 En effet, d’une part, ainsi qu’il a été constaté, le destinataire d’une telle injonction a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité et ainsi de ne pas adopter certaines mesures éventuellement réalisables, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de raisonnables.
60 D’autre part, il n’est pas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n’existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d’une manière ou d’une autre.
61 Il y a lieu de relever qu’il ne ressort nullement de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte que le droit de propriété intellectuelle soit intangible et que, partant, sa protection doive nécessairement être assurée de manière absolue (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 43).
62 Cela étant, les mesures qui sont prises par le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, lors de l’exécution de celle-ci, doivent être suffisamment efficaces pour assurer une protection effective du droit fondamental en cause, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation dudit droit fondamental.
63 Par conséquent, bien que les mesures prises en exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles d’aboutir, le cas échéant, à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle, elles ne sauraient être considérées pour autant comme incompatibles avec l’exigence d’un juste équilibre à trouver, conformément à l’article 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, à condition cependant que, d’une part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, qu’elles aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.
Sur la quatrième question
65 Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
66 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
2) Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.
Signatures

2014

le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 25 mars 2014 Read More
2014

Délégation et sub-délégation de pouvoirs dans l’entreprise : quelle responsabilité pénale ? quelle responsabilité civile ?
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Chambre Criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt n° 1017 du 25 mars 2014 (13-80.376), vient de rappeler une précision importante en matière de délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité au travail.
Le régime juridique de la délégation de pouvoirs, bien qu’il soit aujourd’hui indirectement rattaché à l’article L. 4741-1 du Code du travait est avant tout une construction jurisprudentielle remontant à un arrêt de 1902 (Crim. 28 juin 1902, Bull. crim. no 237, DP 1903. 1. 585, note Roux).
La validité de la délégation ou la subdélégation de pouvoirs faite à un salarié de l’entreprise suppose, comme le rappelle l’arrêt du 25 mars 2014, que le salarié ayant la charge de cette délégation soit doté de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, en plus de l’impossibilité – qui doit être prouvée – pour le délégant ou le sub-délégant de veiller personnellement au respect de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.
Dans le cas d’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation ne revient pas sur la validité de la délégation dont la preuve semble parfaitement bien rapportée par la société mise en cause.
En revanche, c’est sur les effet de cette délégation (ou sub-délégation) de pouvoirs que la Chambre Criminelle revient :e soulignant que le délégataire ou sub-délégataire est est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation.
En conséquence, la délégation ou la sub-délégation établie régulièrement, permet au délégant ou au sub-délégant de se soustraire à sa responsabilité pénale personnelle, mais elle n’exonère aucunement l’entreprise de sa responsabilité pénale.
En clair, le chef d’entreprise peut transférer le risque de condamnation pénale sur la tête de son délégataire, et ledit délégataire sur la tête d’un sub-délégataire… mais ce petit jeu n’affecte en rien le principe de responsabilité de l’entreprise : le délégataire ou sub-délégataire devient le représentant conventionnel de la société dans la matière abordée (en l’occurrence : l’hygiène et la sécurité au travail).
Cette précision, sur le fondement de l’article 121-2 du Code pénal, peut paraitre comme une évidence, mais il semble que certains dirigeants aient oublié le principe selon lequel la délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité est accompagnée du principe de la représentation juridique de l’entreprise par le délégataire ou le subdélégataire, impliquant en conséquence l’engagement de la responsabilité civile et pénale de la société, en raison du manquement du délégataire ou du sub-délégataire à ses obligations.
D’un strict point de vue économique (autrement dit : sur les intérêts civils), il faut bien qu’un responsable paie, et ce n’est pas une personne physique salariée de la société qui est en meilleure position pour cela, d’autant moins si la partie civile n’a pas songé à poursuivre le délégataire ou le sub-délégataire. A défaut, il serait alors trop facile pour les entreprises de se défaire de toute forme de responsabilité, d’autant que les délégations ou sub-délégations mises en place ne jouissent pas de la publicité requise pour qu’une telle exonération de responsabilité puisse-t-être évoquée sérieusement.

2014

Faire effacer/supprimer des contenus sur internet : FAQ ereputation
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Un contenu me concernant ou concernant mon entreprise a été posté sur internet : puis-je le faire supprimer ?
La question de l’effacement d’une information, d’une image ou d’une vidéo est directement liée à la qualification du type d’atteinte portée aux droits de la personne visée (qu’elle soit une entreprise ou une personne physique).
Afin de demander une suppression de contenu, il faut prouver qu’un préjudice est subi par la personne estimant être victime de l’indélicate publication internet… et, surtout, il faut démontrer l’abus commis par la personne ayant publié le contenu litigieux.
Sans abus, pas de retrait : c’est la protection de la liberté d’expression qui le veut.
Pour qu’il y ait « atteinte », il faut d’abord que la victime soit nommément citée, identifiée, aisément identifiable ou s’agissant d’une photo ou d’une vidéo aisément reconnaissable.
Lorsque la victime est nommément citée (nom et prénom), la question de l’atteinte ne pose aucune difficulté, étant entendu que la citation du seul prénom de la victime peut, dans certaines circonstances, suffire (personne célèbre ou photos accompagnant commentaire, par exemple).
Lorsque la personne n’est pas clairement nommée, il faut qu’elle soit identifiable (informations relatives à des faits ou une société suffisant à identifier une personne physique, un dirigeant de société, par exemple) ou aisément reconnaissable (photos ou vidéos prises en qualité et distance suffisante pour distinguer les traits du visage ou un élément d’identification caractéristique).
Le critère est alors apprécié souverainement par le juge.
Quels types d’atteintes / de préjudices / d’abus doivent être en jeu pour permettre le retrait d’une publication sur internet ?
L’atteinte doit être caractérisée, d’une part, par un préjudice certain et prouvé, et d’autre part, par un abus commis par la personne ayant posté le message, l’avis, la photo ou la vidéo litigieuse.
Les cas les plus fréquents sont notamment l’injure et la diffamation d’une personne nommément désignée. Le préjudice, dans ce cas, est une publication nuisant à l’honneur et à la considération (préjudice moral). L’abus quant à lui se caractérise par le caractère outrageant de l’injure ou le caractère non prouvé des déclarations faites (ndla : « non prouvé » ne signifie pas forcément que c’est faux, mais qu’il est impossible d’apporter une preuve de vérité).
Viennent ensuite les photos ou vidéos de personne physiques, prises dans l’intimité de leur vie privée (atteinte à l’image de la personne), au rang desquelles l’atteinte la plus fréquente demeure la photographie ou la vidéo prise par un ex et mise en ligne sur internet. Ces contenus sont généralement accompagnés de commentaires incluant le prénom voire le nom de la personne nue y figurant et il n’est donc pas difficile de démontrer le préjudice subi.
L’abus, dans ce deuxième cas de figure, consiste à ne pas avoir reçu d’autorisation préalable afin de la fixation/captation, de l’enregistrement ou de la transmission de l’image d’une personne.
Enfin on trouve, également, des cas de concurrence déloyale (par dénigrement) commis par des concurrents d’une entreprise qui postent, par exemple, des « faux » avis sur des sites permettant de créer des fiches d’évaluation des produits ou services de différents secteurs d’activité.
Ces cas sont toutefois plus rarement prouvé, en raison notamment de la difficulté d’obtenir l’identité de l’auteur des propos dénigrants.
Dois-je nécessairement faire un constat d’huissier ?
Si des poursuites civiles ou pénales sont envisagées, oui, c’est absolument nécessaire.
Avec les échanges de courriels, c’est le seul mode de preuve recevable en justice, les captures d’écrans ou les impressions de pages sur imprimantes ou, pire, dans un fichier PDF n’étant absolument pas considérée comme un mode de preuve recevable devant Cours et Tribunaux.
Ainsi si un retrait est demandé de manière judiciaire, un constat est indispensable et il doit être fait préalablement à toute notification de demande de retrait et/ou à toute saisine du juge.
Le constat d’huissier n’est pas indispensable dans l’unique hypothèse où l’on sait que l’on agira pas contre l’auteur des contenus litigieux et qu’on ne fera pas de demande de suppression de contenu auprès du juge.
Or, il est de plus en plus fréquent de devoir recourir au juge afin d’obtenir le retrait d’information portant atteinte à l’honneur ou à la vie privée / image d’une personne.
Il est donc fortement conseillé de faire réaliser par un huissier un constat reprenant : les constatations de bases des faits, propos et/ou vidéos alléguées (avec des captures d’écran réalisées par l’huissier).
Peut-on saisir immédiatement le juge d’une demande de suppression de contenu ?
En principe, oui, on peut saisir le juge dès qu’un constat d’huissier est réalisé.
La loi dite « LCEN » de 2004 permet en effet de saisir le juge sur requête ou en référé afin de demander toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Cela signifie qu’il est possible, en principe, de demander le retrait d’un commentaire, d’un article de blog, d’un post sur un forum, d’une vidéo ou d’un photo sur tout site ou réseau social, en demandant une simple ordonnance au juge.
Toutefois, en pratique, les juges exigent de manière quasi systématique que la victime (ou son avocat) ait préalablement notifié à l’éditeur ou à l’hébergeur du site internet ou de réseau social concerné une demande de suppression dans les formes et conditions édictées par la loi dite « LCEN ».
Dans quels délais doit-on agir ?
Lorsque les propos publiés sur internet consistent en une provocation à la commission de certains délits, une diffamation ou une injure le délai imposé par le droit de la presse pour agir en responsabilité est très court : il est de trois (3) mois à compter du premier jour de la première publication (mise en ligne ou publication presse) du contenu litigieux.
Dans les autres cas, le délai pour agir varie de 3 à 5 ans à compter de la publication.
Pour demander l’effacement d’une publication, même si cette publication relève du régime du droit de la presse (délai de 3 mois pour agir en responsabilité), la LCEN ne précise pas qu’il faille être dans le délai de 3 mois.
Toutefois, en pratique, de nombreux magistrats exigent, pour protéger la liberté d’expression, qu’on soit toujours dans le délai de 3 mois, même pour faire jouer une simple demande de suppression de contenu.
A mon sens, cette exigence des magistrats est excessive, notamment au regard de la spécificité d’internet (ndla : cf. le fait que « n’importe qui » peut publier dans l’anonymat, ce qui n’est pas du tout le cas des organes de presse soumis à une responsabilité en cascade et à des mesures de publicité obligatoire).
Combien coute une demande de suppression ?
Le coût d’une demande de suppression commence à 80 EURO TTC (hors frais de timbres postaux) en fonction du nombre de publications à supprimer. Et l’enveloppe moyenne, procédure judiciaire de demande de retrait incluse (par voie de requête) se situe aux alentours de 1160 EURO TTC.
Ces montant peuvent varier substantiellement, notamment lorsqu’on doit procéder par voie de requête(s) afin d’ordonnance(s)… en fonction des difficultés rencontrées et du nombre de requêtes que l’avocat est contrait de déposer plusieurs requêtes.
En tout état de cause, de nombreuses assurances couvrant l’habitation ou les locaux professionnels prévoient des polices « assistance juridique/judiciaire » et une partie des frais de l’avocat peuvent être pris en charge par l’assureur (environ 600 EURO TTC pour une procédure de type « référé » ou « autre demande devant le Président du TGI »).
En tout état de cause, il faut savoir que certaines sociétés de droit étranger sont parfois rétives à exécuter une ordonnance du juge rendue sur requête et qu’une seule ordonnance sur requête ne suffit pas toujours pour obtenir l’effacement ou du moins la disparition des informations concernées.
En fin de course, contrairement à ce qu’indique la loi (LCEN), il n’est quasiment jamais possible de demander le bannissement d’une adresse IP, d’une adresse URL ou d’un serveur auprès des opérateurs de téléphonie (ADSL et mobile) pour empêcher l’accès à des informations préjudiciables hébergées à l’étranger, sur des sites qui ne se conforment pas à la réglementation française et aux décisions de justice françaises.
A ce jour seule l’ARJEL dispose d’un tel pouvoir, car il est assorti de l’obligation de payer les frais des opérateurs au titre de telles opérations de bannissement qui ont un coût substantiel.
Il faut savoir enfin que les requêtes afin d’ordonnance ne sont pas contradictoires (il n’y a pas de partie adverse, mais seulement l’avocat de la victime qui présente des demandes au juge).
Par conséquent, certains magistrats sont très prudents (voire un peu trop prudents) quant à l’octroi (ou non) des mesures préventives sollicitées.
Cela produit parfois des situations de déconvenues surprenantes au détriment de certaines victimes.
Un procès peut-il valoir le coup (ou le coût) ?
Une procédure classique (au fond ou en référé) suppose le respect du contradictoire, un calendrier procédural plus long, et l’observation de règles de fond, de forme et de procédure particulières.
Ces procédures sont donc plus longues et plus couteuses en honoraires d’avocat (selon les cas de figure, la complexité de l’affaire et la durée de la procédure).
Dans le cadre d’une procédure contradictoire, à l’inverse des procédures sur requête afin d’ordonnance, le demandeur peut certes solliciter une indemnité au titre de l’article 700 Cpc (au civil) ou de l’article 475-1 du Cpp (au pénal), ce qui correspond notamment aux frais d’avocat liés à la procédure.
Toutefois, la condamnation est souvent symbolique par rapport aux honoraires réellement acquittés à l’avocat, surtout face à un particulier, et à plus forte raison si ce dernier dispose de faibles revenus.
De plus, la capacité de recouvrer les condamnations, y compris les frais de procédure et d’honoraires d’avocat, est souvent très limitée, surtout lorsque l’atteinte est commise par un particulier dont la surface financière est limitée.
Il faut donc avoir de bonnes raisons et notamment une solide envie de faire payer l’autre, quelqu’en soit le prix, car il ne s’agit pas ici de récupérer, comme certaines victimes le croient parfois de copieux dommages intérêts. C’est plus souvent l’inverse qui se produit, sans compter que pour une bête question de preuves ou de procédure, on peut aboutir à une décision déboutant le demandeur…
Cependant, dans le cadre d’une procédure contradictoire, même en référé, les juges accordent des mesures beaucoup plus contraignantes que dans le cadre d’une procédure d’ordonnance sur requête.
Il y a donc, dans certains cas, un intérêt à recourir notamment au référé afin d’obtenir l’effacement des contenus litigieux, sous astreinte, voire avec l’octroi d’une provision sur dommages intérêts. Ce cas de figure se retrouve notamment dans le cas où un éditeur négligeant omet de satisfaire à une notification LCEN éventuellement suivie d’une ordonnance ordonnant la suppression d’une information, d’une photo ou d’une vidéo.
Faut-il recourir aux services d’une société de nettoyage de e-reputation ?
La procédure de suppression des contenus est parfois longue, surtout lorsque les décision obtenues doivent être exécutées par des sociétés de droit étranger.
Pour prendre un exemple, un société de droit américain gérant un gros moteur de recherche peut parfois obtempérer à une demande faite par courrier A.R. après un délai de plus d’un mois et demi. Parfois, c’est plus rapide, mais c’est loin d’être systématique.
Dans d’autres cas la suppression par des voies juridiques n’est tout simplement pas possible (soit parce qu’il n’est pas possible d’identifier l’éditeur du service, soit parce que les fournisseurs d’accès français ne peuvent pas limiter l’accès à un service ou un serveur ou une adresse IP sans porter préjudice à d’autres services ou d’autres contenus non concernés par la demande).
Dans ce cas, des sociétés comme NET OFFENSIVE proposent des solutions pour « nettoyer » ou du moins dissimuler certaines informations dans les résultats des moteurs de recherche.
Dans tous les cas, il faut utiliser les services d’une société de nettoyage de eréputation qui est assistée d’un avocat connaissant bien la matière car, seule, elle ne pourra aucunement obtenir les mesures et les décisions de justice que seul un avocat peut soutenir.

2013

Dénigrement par voie de presse et sur internet : la e-reputation en droit des affaires
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Peut-on tout écrire au titre de la liberté d’expression sur un concurrent ou un ex-partenaire commercial sans nuire à sa eReputation ? Quel est la limite à ne pas franchir pour ne pas tomber dans un abus de liberté d’expression ? Enfin, en matière de e-réputation, quels sont les critères permettant de distinguer diffamation et dénigrement ?
Voilà autant de questions auxquelles la Cour de cassation s’attache à répondre en ce moment.
Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé que toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par la non-conformité d’un produit aux normes françaises ou européennes, est susceptible de constituer un dénigrement (voir notre article du 10 octobre 2013 dernier, à ce sujet).
Cette fois, par un arrêt n° 1354 du 27 novembre 2013 (12-13.897), la Première chambre civile de la Cour de cassation vient apporter un éclairage supplémentaire quant à la notion de dénigrement et les conséquences du dénigrement entre professionnels.
Rappel des faits :
Un agent général d’une société d’assurance manifeste son intention de démissionner de ses fonctions pour transmettre l’exercice de ses mandats à ses deux fils, qu’il employait comme collaborateurs.
La société d’assurance mandante refuse d’agréer la candidature de ses enfants, confie la gestion des portefeuilles à d’autres intermédiaires et elle interrompt les connexions informatiques de l’agent général.
Ce dernier dénonce la situation au moyen d’un “blog”, d’affiches ou d’articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle.
Déplorant la publicité négative faite à sa e-réputation, la société d’assurance lui notifie sa révocation avec effet immédiat.
Position de la Cour de cassation :
Rejetant le premier moyen de l’agent général sur la cause de la révocation du mandat d’agence, la Cour de cassation retient que si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances.
Il est vrai que l’agent général n’a pas hésité, dans cette affaire, à conduire une partie de la clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats pour en souscrire d’autres auprès d’entreprises d’assurances concurrentes, par l’intermédiaire du cabinet de courtage géré par son épouse.
Dans ces conditions, la Cour ne pouvait faire autrement que de reconnaitre le dénigrement et les actes de concurrence déloyale.
Mais cet arrêt rappelle également une nouvelle distinction quant à l’action menée en matière de concurrence déloyale et dénigrement, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et l’action en diffamation, fondée, quant elle, sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, la Cour d’appel de Besançon avait relevé que les propos dénigrant l’activité de la société d’assurances avaient jeté le discrédit sur ses produits et services, en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d’expression.
Cependant, la Cour d’appel avait cru bon de rejeter les demandes de la société d’assurance en soulignant que les abus de la liberté d’expression commis par voie de presse ne relèveraient pas de la responsabilité civile de droit commun et ne pourraient pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, mais sur le fondement de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881.
La Cour de cassation vient sanctionner le raisonnement de la Cour d’appel en soulignant que le dénigrement (Art. 1382 du code civil) a vocation à s’appliquer par exception à la diffamation (art. 29 L. 29 juillet 1881), dès lors que propos litigieux avaient pour effet ou pour objet de jeter le discrédit sur les produits et service d’un concurrent en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner.
Ce nouvel arrêt a donc le mérite d’illustrer parfaitement comment définir les contours du dénigrement, en s’affranchissant des règles applicables à la diffamation entre professionnels, dès lors que la publication litigieuse a vocation à détourner la clientèle d’un concurrent ou d’une partenaire.
Par conséquent, dans le cas du dénigrement, l’article 1382 du Code civil s’applique dès lors qu’il y a atteinte à la réputation d’une entreprise par la critique de ses produits ou services (que la critique soit avérée ou infondée) créant ainsi une ambiance de concurrence délétère afin de captation de clientèle.
En revanche, la diffamation porte sur la seule atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne morale et physique, par la publication de propos faisant état de faits matériellement inexacts, et sans qu’il soit nécessaire de poursuivre un but de captation ou de détournement de clientèle.
En d’autres termes, si les propos litigieux sont publiés dans un but de concurrence déloyale et donc de dénigrement, l’entreprise victime de tels agissements peut agir sur le fondement de 1382 du Code civil et s’affranchir notamment du délai de prescription court applicable aux infractions de presse (3 mois à compter du jour de première publication).
A défaut de preuve de la poursuite d’objectifs de concurrence déloyale, les propos relèvent alors de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881, à savoir de la diffamation ou de l’injure.

2013

eRéputation & Dénigrement : toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par une non-conformité, est susceptible de constituer un dénigrement
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation vient de juger que la critique formulée à l’encontre d’un produit ou service d’un concurrent engage la responsabilité de son auteur au titre de concurrence déloyale par dénigrement, peu important que la critique formulée soit fondée et avérée.
La Cour de cassation rappelle en outre que les juges du fond ont tout loisir de prononcer une mesure de publication judiciaire, en sus des dommages-intérêts alloués à la victime, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, si cette mesure étant jugée propre à réparer le préjudice subi par la campagne de dénigrement.
Dans cet arrêt, la Cour estime en effet que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte.
Les faits de cette jurisprudence sont relativement simples et transposables à toute matière.
Dans le cas d’espèce, une société commercialisant des bouteilles de butane d’un format particulier (190 gr) s’est aperçue que l’un de ses concurrents commercialisait un produit ne répondant pas aux normes en vigueur pour ce type de bouteilles de gaz pour appareils de camping.
Croyant être dans son bon droit, cette société a adressé des courriers à différents distributeurs pour les informer de cette non-conformité.
C’est en cette communication que la Cour de cassation a estimé qu’il y avait dénigrement.
Il est intéressant de noter que l’auteur du dénigrement, dans ses conclusions, expliquait qu’il n’avait pas averti la DGCCRF, au motif : que « l’intervention de cette dernière aurait été différée et partielle » ; et qu’une telle saisine aurait été peu adaptée à la situation, exposant à des sanctions des sociétés qui étaient par ailleurs ses clientes.
On comprend bien ce que voulait indiquer cette société et elle a partiellement raison dans la mesure ou la DGCCRF n’a pas toujours une action aussi coercitive qu’on pourrait le souhaiter.
Malheureusement l’argument apparait toutefois un peu maladroit dans la mesure où il souligne que l’auteur du dénigrement a visé un concurrent d’une attaque tout en protégeant ses propres partenaires.
C’est précisément un des critères d’un comportement déloyal.
Sur la réparation du préjudice, la Cour de cassation nous apporte là aussi un éclairage intéressant.
La défenderesse à la cassation expose que l’octroi et de dommages-intérêts et d’une mesure de publication au profit de la victime et non seulement excessif, mais également qu’une telle publication n’est prévue par aucun texte.
L’argument invoqué fait implicitement référence aux articles L.331-1-4 (en matière de droit d’auteur et bases de données), L.521-8 (en matière de dessins et modèles), L.615-7-1 (en matière de droit des brevets) et L.716-15 (en matière de droit des marques) du Code de la propriété intellectuelle.
En effet, dans ces matières, la réparation / sanction par mesure de publication de la décision de justice ou d’un extrait de celle-ci peut être ordonnée.
L’argument est intelligent : il consiste à soutenir qu’une mesure de publication est une forme de sanction, non prévue par la loi (et notamment une loi pénale, une incrimination), et par conséquent illicite.
Toutefois, la réponse de la Cour à ce moyen n’est pas moins habile.
La réponse de la Cour revient à dire de manière synthétique : non, il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure de réparation décidée souverainement pas les premiers juges.
Il résulte de cette très intéressante jurisprudence que la critique, même objective et avérée, sur un produit ou un service d’un concurrent (frappé de non conformité, voire même d’une autre tare plus grave) est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale par dénigrement.
L’autre enseignement s’apparente au « retour de bâton » : celui qui a voulu être arroseur, se retrouve arrosé… et dans des proportions bien plus importantes, puisque quelques correspondances privées ont valu à leur malheureux auteur d’être cloué au pilori sur la place publique.
En effet, dans le cas d’espèce pour deux ou trois courriers adressés à des professionnels du secteur, l’auteur du dénigrement voit un extrait du jugement à son encontre publié sur son propre site internet ainsi que dans deux magazines, le tout à ses frais, bien entendu.
La sanction a de quoi faire réfléchir.

2013

Le nom de domaine doit être distinctif pour assurer une protection et le NDD descriptif peut engager la responsabilité de son exploitant
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /C’est l’idée qui ressort des dernières jurisprudences en la matière : un nom de domaine ayant un caractère descriptif ne permet pas à son titulaire d’agir en concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise concurrente qui enregistrera le même nom de domaine ou un nom de domaine proche, même avec la même extension, visant le même territoire (voire la même localité).
Le nom de domaine descriptif ne confère aucun droit d’exclusivité et ne permet pas d’agir en concurrence déloyale
Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour d’appel de Bastia avait en effet déjà statué sur la question en retenant notamment que « en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer ’un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité. »
Il s’agissait, en l’espèce, d’un conflit intervenant entre le déposant du nom de domaine « mariagesencorse.com » et la déposante du nom de domaine « mariageencorse.com ».
Le premier déposant, s’imaginant sans doute que le premier arrivé est le premier servi et qu’il est forcément protégé juridiquement, estime être victime d’usurpation de son nom de domaine ’mariagesencorse.com’.
Il demande donc réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, estimant avoir subi une atteinte préjudiciable à son nom de domaine, constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme.
Le Tribunal de commerce d’Ajaccio, s’estimant compétent à tort pour juger de ce contentieux en droit des marques (même portant sur la question connexe des actes de concurrence déloyale), donne raison au demandeur.
La Cour d’appel de Bastia retient quant à elle qu’il n’y avait pas de ressemblance entre les deux sites concurrent et que le site « www.mariagesencorse.com est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet. »
La Cour en déduit très justement que le simple dépôt auprès d’un registrar d’un nom de domaine descriptif ne confère aucun droit, ni aucun monopole à son titulaire, lequel se voit privé, subséquemment, de toute action en concurrence déloyale contre des sites internet ayant la même activités, même sur le même territoire et usant d’un signe descriptif très proche voire identique à titre de nom de domaine.
Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 24 mai 2013 a retenu une solution similaire à l’occasion d’un contentieux opposant les titulaires des noms de domaines « e-obseques.fr » et« i-obseques-paris.fr », le premier appartenant à une société privée et son gérant, demandeurs à l’instance, et l’autre à la ville de Paris, défenderesse.
Le Tribunal de commerce, à l’instar de la Cour d’appel de Bastia, retient également que la société privée et son gérant « ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif », outre le fait que les demandeurs « ne sont pas en mesure d’établir qu’une quelconque confusion soit possible entre le graphisme de leur site et celui de la société ».
Cette idée a d’ailleurs pour origine le fait que pour avoir une marque forte et qui pale d’elle même, il faut choisir un signe lequel, par définition, doit permettre de se distinguer des concurrents et non de se confondre avec.
Les critères permettant d’agir en concurrence déloyale au titre du plagiat d’un site internet
On notera, à ce titre, que ces solutions rejoignent celles déjà adoptées par le Tribunal de grande instance de Paris qui retient usuellement que l’imitation des fonctionnalités et la reproduction quasi-servile des conditions générales d’utilisation d’un site internet sont constitutives d’actes de concurrence déloyale (TGI, 3ème civile, 2ème Section, 15 mars 2013).
La solution de bon sens donne par conséquent une idée précise de ce que doit désormais relever l’exploitant d’un site internet pour poursuivre en concurrence déloyale un site concurrent :
– L’imitation d’un signe distinctif éventuellement déposé à titre de marque, de dénomination sociale et/ou de nom commercial ;
et/ou
– L’imitation d’un graphisme et/ou des fonctionnalités / conditions générales d’utilisation.
Ces critères ne sont pas nécessairement limitatifs, mais en l’absence de contrefaçon d’éléments de propriété intellectuelle, ils doivent servir de référence de base avant d’agir en concurrence déloyale contre un site internet concurrent.
Exploiter un nom de domaine descriptif peut être un acte de concurrence déloyale
Pour aller plus loin, rappelons que la Cour de cassation avait retenu, dans un arrêt du 04 mai 2012, que le fait (pour un avocat) d’enregistrer un signe descriptif à titre de nom de domaine (« avocat-divorce.com », en l’espèce) constituait « une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale » (Cass. Civ. 1ère, 4 mai 2012, N° de pourvoi: 11-11180, publié sur Legifrance).
Le problème était par conséquent carrément inversé : c’est le déposant d’un nom de domaine descriptif qui aurait pu être attaqué pour concurrence déloyale par ses concurrents, non titulaires du même nom de domaine.
Certes cette jurisprudence s’applique à une profession réglementée (avocats)… néanmoins, l’argument, souligné par la Cour de cassation, consistant à soutenir qu’il y a concurrence déloyale du fait de l’enregistrement d’un nom de domaine descriptif est, à nos yeux, une invitation à ouvrir droit à poursuites à tout concurrent !
Contrairement à ce qu’on peut écrire faussement certains avocats, il n’est donc surtout pas question de course au référencement : au contraire, les noms de domaines génériques sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur déposant et/ou de leur exploitant.
En effet, une telle jurisprudence dénote clairement une hostilité certaine de la haute juridiction à l’égard des signes descriptifs enregistrés à titre de nom de domaine.
Peut être que certains professionnels y verront une opportunité pour faire cesser des agissements de concurrents peu scrupuleux qui achètent des noms de domaines descriptifs à tour de bras pour « occuper l’espace » et acquérir de la visibilité.
Il se pourrait que le mouvement jurisprudentiel de ces derniers mois leur offre, en effet, une voie d’action.
Et ce serait logique puisqu’en droit des marques, tout intéressé peut invoquer à titre de moyen en défense la nullité d’un signe descriptif : il y a donc une certaine logique à neutraliser toute forme de monopole, quel qu’il soit, y compris s’agissant d’un nom de domaine descriptif quant à l’activité auquel il se rapporte.
En sus, cette hostilité rejoint la nouvelle (quoique de moins en moins « nouvelle ») politique de référencement de Google qui ne souhaite plus donner la part belle aux noms de domaine descriptifs, précisément afin d’éviter des abus en matière de référencement.
Il semble donc que l’achat de nom de domaines descriptifs pour être « bien vus » sur le net risque d’être « mal vus », non seulement par Google, mais également désormais, par les juridictions françaises.

2006

Salarié, contrat de travail et droit au brevet de l’employeur
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /DROIT AU BREVET ET DROIT A LA PATERNITÉ
Le Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’inventeur salarié doit être mentionné lors de la
demande de dépôt de brevet, en raison de son droit à la paternité de l’invention.
Loin d’être uniquement rhétorique, ce droit permet notamment à l’inventeur-salarié d’apposer son nom
sur toute référence au brevet d’invention dont il est l’auteur. Il pourra notamment utiliser ce droit à titre
de citation dans un C.V., dans une correspondance ou sur son site internet personnel.
L’exercice de ce droit par le salarié s’effectue grâce à la communication à son employeur d’un formulaire de déclaration d’invention
(disponible sur le site internet de l’INPI). A noter que cette déclaration peut être adressée directement à l’employeur ou par
l’intermédiaire de l’INPI.
Le droit au brevet proprement dit (à savoir : la titularité des droits d’exploitation industrielle de
l’invention) n’appartient toutefois au salarié que si, cumulativement :
– Le salarié agit en dehors de toute mission inventive confiée
par l’employeur ;
– L’invention est faite en dehors de l’exécution de ses fonctions ;
– Le salarié n’utilise aucun moyen, connaissance, donnée ou technique spécifiques à l’entreprise ou confiés par elle.
La chambre sociale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 21 septembre 2011 que l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel l’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur n’est aucunement discutable.
En tout état de cause, les cas de figure dans lesquels le salarié peut revendiquer pour lui-même le droit au brevet sont assez limités.
DROIT AU BREVET ET CONTRAT DE TRAVAIL
Un contrat de travail d’ingénieur ou de directeur de R&D par exemple, contient le plus souvent une
clause précisant une mission générale d’activité inventive dans un domaine particulier. Dans ce cas,
l’objet même du contrat de travail étant spécifiquement l’invention, le droit au brevet revient
contractuellement et de plein droit à l’employeur (on parle alors d’une « invention de mission »).
Dans les autres cas, il est fortement recommandé aux entreprises de prévoir une clause spécifique organisant le droit au brevet, notamment par un rappel de la loi.
A ce titre, il convient de noter que le salarié affecté à une mission banale et non inventive découvrant, dans le cadre de son travail ou avec ses outils de travail, un procédé
technique améliorant les performances industrielles de son entreprise, a droit au brevet à titre
personnel, sous réserve que son employeur ne souhaite pas le revendiquer dans le délai de quatre mois, comme le prévoit l’article R.611-7 du Code de la propriété intellectuelle (on parle alors d’une « invention hors mission attribuable »).
L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRER LE SALARIE
Dans le cas d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, le salarié a toujours droit à une rémunération, mais dans des proportions parfois très différentes selon les cas de figure.
Dans le cas d’une invention de mission, la rémunération supplémentaire à laquelle le salarié a droit est définie par la convention collective, un accord d’entreprise ou le contrat de travail.
Il est par conséquent important pour les parties, en cas de silence de la convention collective de verrouiller cette rémunération au moment de la signature du contrat.
De même, le salarié aura intérêt à prendre connaissance de la convention collective et de la rémunération y figurant pour savoir si ce complément de rémunération lui convient avant de s’engager dans le contrat de travail.
Dans le cas d’une invention hors mission attribuable, le transfert du droit au brevet, tel que prévu à l’article L.611-7-2 du Code de la propriété intellectuelle, a pour contrepartie l’obligation pour l’employeur de rémunérer le salarié à la hauteur de sa découverte… laquelle rémunération s’apprécie au regard de « l’utilité industrielle et commerciale de l’invention », à savoir : selon
l’importance, la difficulté et la qualité de l’invention, et non pas selon son seul intérêt économique (quoique ce dernier joue un rôle certain).
La rémunération au titre d’une invention hors mission est, par exemple, définie par rapport à l’intérêt scientifique et les
difficultés de la mise au point pratique de l’invention ainsi que sur l’importance de la contribution
personnelle de son auteur (Com. 21 novembre 2000, Arrêt n° 2086. Rejet. Pourvoi n° 98-11.900.)
En tout état de cause, que ce soit dans le cadre d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, le silence du contrat de travail et/ou de la convention collective, à défaut d’accord entre les parties, conduiront quasi inévitablement ces dernières devant le juge afin d’expertise judiciaire.
Enfin, concernant la fraude faite aux droits de l’entreprise par un salarié, il a été jugé que le dépôt d’un brevet par un ancien salarié immédiatement après
son départ de l’entreprise justifiait valablement de l’action en revendication de l’employeur parce que
l’invention litigieuse avait été découverte dans le domaine précis d’activité de ladite entreprise, et grâce
aux moyens matériels et techniques de l’entreprise sans lesquels cette découverte n’aurait pas été
possible (CA Paris, 12 mars 1997, Sté Techni DD et Daniel Topczewski c/ Ets Grillat Jaeger et a.).
Précisons à l’égard de cet exemple que le dépôt fait par le salarié peut être considéré comme un acte de concurrence déloyale et parasitaire de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

2006

Le droit d’auteur et le salarié
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Aux termes de l’article L.111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), la seule existence d’un contrat de louage d’ouvrage (ou d’un contrat de travail) conclu avec un auteur n’emporte pas cession des droits de l’auteur (prestataire ou salarié) à son cocontractant (client ou employeur).
Le CPI prévoit que la cession des droits sur une création doit être expresse et constatée par un écrit, lequel doit, de surcroît, comporter des mentions obligatoires précises, quelle que soit la création ou l’œuvre objet de la cession, le contrat de droit d’auteur étant d’interprétation restrictive (article L.131-3 du CPI).
Parmi ces mentions obligatoires, il convient de prévoir au contrat de cession notamment et sans que ce soit limitatif : durée, territoire, prix de l’œuvre (et donc une rémunération !), droits cédés, etc.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe de cession écrite et préalable des droits, et parmi elles, notamment :
- Les œuvres collectives (dont les logiciels notamment) issues d’une élaboration d’ensemble au sein de l’entreprise, pour lesquelles la qualité d’auteur est attribuée par présomption à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée (article L.113-1 du CPI)
- Les droits patrimoniaux (à l’exclusion du droit moral) afférents aux articles de presse sont automatiquement dévolus à l’éditeur du journal pour lequel les journalistes travaillent (le CPI, le Code du travail et les conventions collectives applicables aux journalistes organisent un mécanisme de transfert des droits patrimoniaux à l’employeur limité à une première publication seulement) ;
Ces exceptions, les plus courantes, sont toutefois à modérer.
En effet, les présomptions des articles L.113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle peuvent parfaitement être combattues par la preuve contraire, lorsque elle est possible.
A noter à ce titre : depuis la loi DAVSI du 1er août 2006, les créations des agents de l’Etat (lesquelles faisaient parties des exceptions précitées) suivent désormais le même régime que les créations salariées et ne sont plus automatiquement dévolues à l’autorité publique.
De même, le contrat de travail ou l’accord de pige n’emporte pas la cession des droits patrimoniaux des journalistes au profit de l’éditeur au-delà de la première publication de l’article cédé. Toute autre utilisation doit donc faire l’objet d’une cession préalable, séparée et rémunérée.
Enfin, lorsque l’œuvre est réalisée en dehors de toute mission de service public (ou sans lien avec le service), l’agent public reste seul titulaire des droits sur son œuvre, y incluant les droits moraux et patrimoniaux.
L’interprétation des situations les moins évidentes seront à départager par le Tribunal de grande instance territorialement compétent.
Mais, en dehors des cas définis au CPI, le salarié ou le cocontractant (contrat de service) est seul titulaire de ses créations, dès lors qu’il n’est pas organisé par écrit et dans les formes imposées par la loi, une cession de ses droits patrimoniaux (le droit moral restant incessible).
En conséquence, l’employeur exploitant les créations de ses salariés ou cocontractants sans cession préalable se rend coupable d’acte(s) de contrefaçon, le paiement du salaire ou de la prestation de service n’entraînant aucun transfert des droits.
En tout état de cause, la clause du contrat de travail transférant automatiquement toutes les créations du salarié à l’employeur est nulle, en vertu des dispositions des articles L.111-1 et L.131-1 du CPI prévoyant la nullité de la cession des œuvres futures.
En conséquence, pour la grande majorité des cas, il convient de prévoir une cession au cas par cas des créations des salariés, bien que ce soit plus lourd en termes de gestion, notamment en cas de créations régulières, voire importantes, au sein de l’entreprise.
Aisément sanctionné de nullité du fait de son formalisme, la rédaction du contrat de cession de droits d’auteur n’est donc pas sans risque et nécessite la plupart du temps l’intervention d’un juriste ou d’un avocat exerçant en droit de la propriété intellectuelle.
Peut-être les employeurs peuvent-ils néanmoins espérer que le législateur ouvre un jour la porte au contrat de travail incorporant une mission de création en droit d’auteur, comme c’est le cas en matière de brevets.