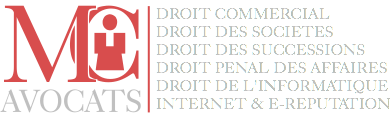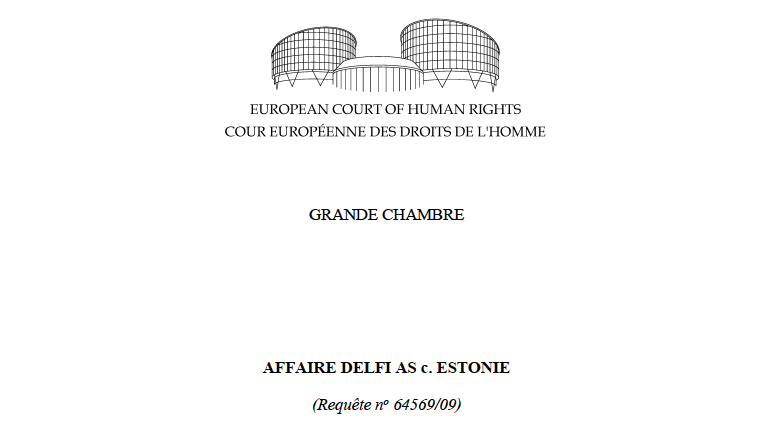2015

Augmentation des droits de mutation sur les immeubles à Paris au 1er janvier 2016
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013, dite « loi de finances pour 2014 » disposait que les départements pouvaient augmenter le taux des droits de mutation de 3.8% à 4,5%, soit une hausse maximale de +0,7% (article 77 de la loi de finances).
Pour être appliquée, cette hausse doit être votée par le département, lequel peut décider d’une hausse inférieure ou égale à 0,7%.
Or, à ce jour, seuls les départements suivants n’avaient pas encore augmenté les « DMTO » (pour Droits de Mutation à Titre Onéreux – il ne s’agit pas d’une « taxe » – dus par l’acquéreur d’un bien immobilier) :
Indre (36)
Isère (38)
Mayenne (53)
Morbihan (56)
Paris (75)
Martinique (972)
Mayotte (976)
C’est désormais fini pour Paris (75) qui vient de décider de l’augmentation de 3,8% à 4,5% les DMTO, en suivant le même exemple que celui des Yvelines (78) qui a fait partie des derniers départements à voter la même augmentation.
Il s’en suit qu’il est fortement recommandé aux acquéreurs de biens sis à Paris de finaliser leur demande de prêt et de signer leur acte définitif chez le notaire avant le 31 décembre 2015 pour éviter un surcoût de 0,7% (soit 5.250,00€ pour un bien d’un prix de 750.000,00 EURO par exemple, ce qui pourrait représenter, pour certains ménages, le montant cumulé de leur taxe foncière et de leur taxe d’habitation).

2015

E-réputation : 4 leçons à retenir concernant le nettoyage judiciaire d’avis négatifs pour 2015/2016
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Toutes les entreprises sont visées par des avis négatifs sur internet, et pas seulement les hôtels qui sont en outre confrontés à des avis de clients effectifs, sur des portails tels que Hotels.com, Booking ou Tripadvisor, à l’inverse de nombreux autres sites hébergeant des avis d’internautes. Ces avis sont pourtant souvent moins contrôlés, excessifs voire parfois totalement diffamatoires ou dénigrants pour l’entreprise. Il n’est pas impossible de réagir à et de nettoyer des avis négatifs, mais la tâche est devenue plus difficile en 2015 qu’auparavant : la loi n’a pourtant pas changé ; c’est le contrôle du juge des requêtes qui s’est resserré. Voici les 5 leçons à retenir dans ce nouveau contexte.
1. L’effacement à première demande doit prendre la forme d’une notification LCEN.
Bien entendu, les entreprises peuvent faire le choix de recourir d’abord à une solution amiable, en utilisant les outils de « plainte » ou de « modération » présents sur de nombreux portails, ou en passant par l’administrateur du site, avec des chances de succès parfois très approximatives (mais dans certains cas cela fonctionne, il ne faut donc pas s’en priver) pour demander la suppression de l’avis.
A défaut, il convient avant toute démarche judiciaire, d’adresser une mise en demeure mise en forme selon les prescriptions de l’article 6 de la LCEN. C’est indispensable, et le juge exigera que cette démarche soit accomplie avant qu’on viennent le saisir, car le principe de cet article de loi est que la personne s’estimant victime d’un avis négatif ou d’un faux avis sur internet doit d’abord saisir l’hébergeur d’une demande de retrait de cet avis négatif, de manière formelle.
2. Lors d’une première requête, le juge n’ordonnera l’effacement que des contenus d’une particulière gravité
C’est cela qui a changé : la lecture de l’article 6 de la LCEN permettait, il n’y a pas si longtemps, d’obtenir l’effacement d’un avis négatif dès lors qu’on démontrait le caractère illicite de l’avis négatif litigieux, un préjudice à faire cesser, et le refus de l’hébergeur de supprimer l’avis au mépris de la LCEN.
Aujourd’hui, en remettant la protection de la liberté d’expression en avant, le juge refuse d’effacer un avis négatif, même clairement dénigrant, diffamant ou injurieux, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’auteur du message litigieux n’est pas identifiable.
3. La condition d’effacement des contenus après l’échec d’identification de l’internaute : une procédure plus longue
L’effacement de l’avis négatif pourra donc avoir lieu : sur requête, s’il est rapporté la preuve que l’auteur de l’avis litigieux n’est pas identifiable, ou par voie d’une action au fond (action en diffamation, injure ou responsabilité civile) s’il s’avère qu’une identification a été rendue possible.
Il est bien évident que de soumettre l’effacement d’un avis négatif à la condition que soit rapportée la preuve de l’impossibilité de son identification rallonge considérablement les délais permettant d’introduire une procédure, ce qui a un impact sur le choix du procès au fond à intenter si l’auteur de l’avis négatif est identifié.
4. Pour l’action au fond, préférer l’action en dénigrement à l’action en diffamation
Bien souvent, lorsqu’on obtient l’identification de l’auteur, il est trop tard pour agir sur le terrain du droit de la presse (c’est à dire, essentiellement, pour cause de diffamation ou d’injure, s’agissant d’avis négatifs sur des produits ou services d’entreprises), puisque le délai de prescription n’est que de 3 mois à compter de la première publication du message litigieux.
De plus, l’action en diffamation suppose de rapporter la preuve du caractère erroné / faux du texte de l’avis négatif, de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de l’entreprise, tout en s’affranchissant du risque de rapport de preuves de vérité par l’auteur des propos.
A l’inverse, dans un procès en dénigrement, fondé sur l’article 1382 du Code civil, il suffit que l’avis négatif porte atteinte à l’image de l’entreprise, afin de détournement de clientèle, en usant de critiques, mêmes exactes, à l’encontre d’un produit ou service désigné ou identifiable, peu important que le message soit publié par une personne concurrente ou non l’entreprise visée. De plus, l’action en dénigrement se prescrit par 5 ans : elles est donc plus facile à mettre en oeuvre qu’une action en diffamation.

2015

La CEDH valide le principe de responsabilité « LCEN » des hébergeurs pour les avis et commentaires d’internautes
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par un arrêt pris en Grande Chambre, en date du 16 juin 2015, a jugé que la loi « SSI » estonienne (loi sur les Services de la Société d’Information) était conforme à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Hommes et des Libertés Fondamentales (CDHLF) sur la liberté d’expression.
Or, la loi « SSI » estonienne, au même titre que la loi « LCEN » française, s’inscrivent dans la droite ligne des directives « SSI » 98/34/CE et « commerce électronique » 200/31/CE, comme le rappelle la Cour Européenne. Ce qui vaut pour la loi estonienne vaut donc pour la loi française.
A ce titre, cet arrêt souligne que les éditeurs de contenus, qui sont aussi hébergeurs de commentaires ou d’avis d’internautes sur ces contenus, ont une responsabilité limitée mais certaine, non seulement quant au prompt retrait des commentaires excessifs dépassant le cadre de la liberté d’expression, et à plus forte raison lorsque ces éditeurs-hébergeurs ne s’assurent pas de moyens réalistes pour tenir les auteurs desdits commentaires / avis responsables de leurs propos.
Pour arriver à cette solution, la Cour souligne bien que la législation estonienne, comme la législation française, met en avant le principe de liberté d’expression et de responsabilité limitée des hébergeurs de contenus, sans aucune obligation de contrôle a priori des informations hébergées.
Principe de liberté d’expression sauvegardé, pas de contrôle a priori, responsabilité limitée des hébergeurs
Dans la législation estonienne, poursuit la Cour dans son analyse, seuls sont susceptibles d’être poursuivies les atteintes à la personnalité, la diffusion d’informations fausses, et la responsabilité pour faute [süü] équivalent de notre article 1382 du Code civil.
Or, c’est exactement le type de législation préconisée par le Conseil de l’Europe dans sa Déclaration sur la liberté de la communication sur l’Internet du 28 mai 2003, texte qui est désormais consacré par l’important arrêt de la CEDH.
En effet, dans la déclaration du 28 mai 2003, le Conseil de l’Europe précise notamment que « Afin d’assurer une protection contre les surveillances en ligne et de favoriser l’expression libre d’informations et d’idées, les États membres devraient respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité. Cela n’empêche pas les États membres de prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux, conformément à la législation nationale, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et aux autres traités internationaux dans le domaine de la justice et de la police« .
Que la CNIL se le tienne pour dit, depuis plus de 12 ans : il ne serait pas illégitime de conserver des données sur les utilisateurs de services en lignes, même à titre gratuit, pour leur identification future de l’auteur d’un éventuel délit ou d’une éventuelle atteinte aux droits d’un tiers. Cela n’est toutefois pas prévu (ou du moins pour une durée bien trop limitée) par le cadre légal sur la conservation des données personnelles, telle qu’encadrée par la CNIL dans ses précieuses déclarations CNIL que nous connaissons tous.
Responsabilité en cas de retrait tardif et de défaut de moyen d’identification de(s) (l’) auteur(s) de l’infraction ou de l’atteinte
Quant au contrôle – a posteriori – après signalement d’un contenu illicite, le Conseil de l’Europe détaille les moyens que peuvent employer les éditeurs de contenus qui hébergent également les commentaires ou avis des internautes sous leurs publications.
Enfin, la Cour rappelle les dispositions de la Directive « Services de la société de l’information » 98/34/CE dans la droite ligne de laquelle se situent les législations estoniennes et française.
En conséquence, l’arrêt relève notamment que l’insuffisance des mesures prises par la société d’édition requérante : 1) pour retirer sans délai après leur publication les propos litigieux ; et 2) pour assurer une possibilité réaliste de tenir les auteurs des commentaires pour responsables de leurs propos ; est susceptible d’engager la responsabilité d’un éditeur-hébergeur sans que ce dernier puisse arguer de la violation par la législation de son pays de l’article 10 de la CDHLF.

2015

Piratage informatique : vers une nouvelle définition du vol de fichiers informatiques ?
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Dans un arrêt du 20 mai 2015 (publié au bulletin), la Cour de cassation vient de préciser la définition de la fraude informatique en retenant qu’il suffit que le pirate ait eu connaissance de la présence d’un système de protection (par identifiant et mot de passe) pour que soit retenu le délit de piratage informatique… même si ledit système de protection a été « contourné » par la simple utilisation d’un moteur de recherche internet. Etrange.
On est bien loin du hacking / piratage informatique tel qu’on l’entend classiquement, et dont le jeu consiste à casser ou à contourner un système de protection informatique en passant par une faille (un port ouvert, une backdoor ou encore un outil spécialisé).
Décryptage.
Le piratage informatique / hacking est retenu dès que l’auteur des faits sait qu’il existe un système de protection des données informatiques et qu’il persiste quand même dans son action
C’est aussi simple que cela : l’internaute qui s’introduit sur le site extranet d’une personne physique ou morale, même à la suite d’une défaillance technique du système de protection, et sans être à l’origine de cette défaillance, et qui se maintient dans ce système pour y dérober des fichiers alors qu’il a préalablement constaté l’existence d’un contrôle d’accès est auteur d’actes de maintien frauduleux sur un système automatisé de données.
Cela peut paraitre injuste au yeux de certains, puisque c’est l’absence de sécurité informatique (en panne) qui rend les informations, prétendument « volées », en réalité disponibles au public par l’utilisation d’un simple moteur de recherches internet.
Pourtant, il faut distinguer l’accès frauduleux et le maintien frauduleux.
L’accès étant facilité par une panne du système informatique, le délit d’accès frauduleux ne peut pas être retenu, certes… Mais cela ne signifie pas qu’on ne peut pas reprocher à l’auteur des faits un maintien frauduleux s’il sait qu’en principe il faut un identifiant et un mot de passe pour accéder à ces informations. C’est le raisonnement suivi par la Cour de cassation.
Pourtant cette analyse ne résiste pas à la décortication de la fraude informatique, laquelle est nécessaire à la matérialisation du délit, qui à mon sens très mal définie dans cet arrêt, je pense à dessein, pour des raisons politiques : c’est ANSES la victime.
Un internaute complètement noob (newbie) peut donc parfaitement être reconu fraudeur et être condamné pour piratage informatique en utilisant Google
Pas besoin d’être un geek ou un hacker, donc, pour être condamné. C’est la leçon à tirer de cet arrêt de la Cour de cassation qui met fin à un mouvement oscillant de la jurisprudence de certaines Cour d’appel et de précédentes positions de la Cour de cassation qui tantôt acceptaient de manière variable la notion d’introduction frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données (STAD). Depuis 2004, la loi s’est élargi aux notions d’accès et de maintien dans un STAD, certes, mais la Cour de cassation s’engouffre dans une appréciation laconique de la fraude informatique qui permet un tel accès et/ou maintien.
En effet, il convient de rappeler que le texte de l’article 323-1 du Code pénal, mis à jour par la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique dispose que : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende« .
Or, l’arrêt retient que l’auteur des faits déclarait avoir découvert tous ces documents en libre accès après une recherche complexe sur le moteur de recherche Google et qu’il affirmait être arrivé par erreur au coeur de l’extranet de l’ANSES. Ce n’est donc pas par une manoeuvre frauduleuse qu’il s’est retrouvé dans l’arborescence de l’intranet de l’ANSES… mais par inadvertance.
Il s’en suit que la notion de « fraude » est au coeur de l’appréciation et que la qualification juridique des faits : l’auteur des faits fraude-t-il lorsqu’il n’utilise aucun outil de piratage, ni aucun savoir-faire illicite de hacking, ni aucune manoeuvre particulière ? Autrement dit, l’auteur des faits fraude-t-il lorsqu’il utilise un moteur de recherche internet avec un navigateur pour récupérer une information (un fichier informatique) rendu disponible publiquement en raison d’un défaillance du système de sécurité ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative en se bornant à souligner que l’auteur s’est maintenu sur l’extranet litigieux « alors qu’il avait constaté l’existence d’un contrôle d’accès« . Il a constaté l’existence d’un contrôle d’accès ne signifie pas qu’il avait conscience que ce contrôle d’accès régissait forcément l’accès aux données litigieuses. Comment le savoir de toute façon, si par définition, ce contrôle d’accès ne fonctionne pas.
C’est critiquable : si je suis mené par Google sur un site extranet non sécurisé (qui lorsqu’il est ouvert a toutes les apparences d’un site internet), comment faire la différence entre ce que j’ai le droit d’y faire ou pas ? La réponse est simple : certains extranets ont des zones d’informations publiques (généralement en lien avec un site internet mais pas obligatoirement) et des zones d’informations privées, protégées par mot de passe. Si la sécurité ne fonctionne pas, je ne ferai donc pas nécessairement la différence.
La Cour de cassation élude admirablement bien la question…. pourtant la réponse à cette question fournit un autre élément : l’élément moral / intentionnel de l’infraction de maintien frauduleux dans un système automatisé de données.
La conscience d’être dans un système informatique protégé : l’élément moral de l’infraction du maintien frauduleux
La Cour de cassation adopte un raisonnement confus dans un « attendu » fouilli mêlant deux délits différents (« maintien frauduleux » – art. 323-1 du Code pénal et « vol » – art. 311-1 du Code pénal).
Sur la question de maintien frauduleux, la seule conscience d’être dans un système informatique protégé suffit à caractériser l’élément matériel. Dont acte : le délit de maintien frauduleux est un délit matériel avec un élément matériel extrêmement fugace. Il fallait que ce soit dit. Je ne suis pas d’accord, mais on le saura pour la prochaine fois.
Sur l’autre incrimination retenue, on notera que ce n’est pas le délit « d’extraction, de détention, de reproduction, de transmission, de suppression ou de modification frauduleuse des données » de l’article 323-3 du Code pénal qui a été instruit et poursuivi dans cette affaire… mais le délit de « vol » de l’article 311-1 du Code pénal.
La Cour de cassation aurait donc dû écarter cette incrimination de vol comme n’étant pas applicable au délit informatique de téléchargement illicite de fichiers et données.
Cela semble ne choquer personne et pourtant cela devrait. En appliquant l’incrimination pénale de « vol » à un délit informatique « d’extraction et de reproduction de données informatique », la Cour de cassation méconnaît le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Si le législateur a créé l’article 323-3 du Code pénal, ce n’est pas pour faire joli. C’est parce qu’il n’y a pas de vol – autrement dit pas de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui – lorsqu’on télécharge un fichier informatique. Le délit n’est matériellement pas constitué, car il s’agit d’une simple reproduction, pas d’une soustraction de la chose d’autrui.
Pourtant c’est bien en s’appuyant sur le prétendu « vol » commis que la Cour de cassation va retenir la responsabilité du dangereux prévenu, comme signe de la volonté de nuire de l’auteur des faits. Etrange que de s’appuyer sur un délit de vol non constitué pour asseoir une décision de maintien frauduleux dans un système automatisé de données.
La préparation du délit motivé par un mobile dérisoire, gage de la volonté de nuire ?
Il est vrai cependant que l’auteur des faits était caché derrière un VPN panaméen lors de sa recherche internet complexe sur Google laquelle l’a mené à l’extranet litigieux et aux données informatiques litigieuses. Je reconnais volontiers que c’est suspect, comme attitude, et qu’on est peut être pas face à un internaute classique qui utilise son adresse IP française de son fournisseur d’accès français.
D’un autre côté l’utilisation de VPN se démocratise, car un VPN permet notamment de faire des recherches sans être identifié et « profilé » par Google dans les recherches opérées (pourvu qu’on ne se connecte pas à son compte Google évidemment). De là, à en déduire une intention criminelle, il ne faut pas aller trop vite.
Et c’est là que réside la plus surprenante tournure de cet arrêt : pour quel mobile l’auteur se voit-il reproché un maintien frauduleux dans un système automatisé de données et un vol de fichiers informatiques ? Réponse de la Cour de cassation : pour « avoir seulement fait une extraction de 250 mégaoctets qu’il avait utilisés pour argumenter son article sur la légionellose » et pour « avoir communiqué des documents à un autre rédacteur du site ».
Ah, oui ! Ca valait la peine de le condamner celui-là (ironie)… Et de tordre le bras à des incriminations pénales pour les appliquer à la va-vite ? Moins sûr.
Moralité, cet espiègle internaute a été condamné à 3.000,00 € d’amende. Vous me direz « c’est peu » ? Eh bien, non, c’est déjà trop dans un pays où le salaire moyen net mensuel, par ménage, est de 2 410 € nets / mois… surtout lorsque notre plus haute institution judiciaire jongle avec incriminations pénales pour asseoir une décision contestable.
C’est surtout trop au regard de ce que coûte l’ANSES dans les rapports de la Cour des comptes : l’ANSES a certainement les moyens de s’offrir un bon administrateur réseau et du matériel de qualité. Néanmoins, j’ai un peu l’impression que c’est le justiciable qui est placé au sens propre, sur le banc des accusés. Pas l’autorité publique qui a géré sa sécurité informatique de manière discutable.
On aura compris la leçon.

2015

Arrêt n° 617 du 6 mars 2015 (14-84.339) - Cour de cassation - Assemblée plénière
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/617_6_31235.html Read More
2015

Arrêt n° 74 du 17 février 2015 (13-88.129) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2015:CR00074
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/74_17_31161.html Read More
2015

Le coût du droit de suite, qui doit être payé à l’auteur lors de toute revente d’une œuvre d’art par un professionnel, peut tout aussi bien être supporté définitivement par le vendeur que par l’acheteur
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le droit de suite est défini par une directive de l’Union Européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001 et par l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle (en droit français) comme le droit pour l’auteur d’une œuvre d’art originale à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession.
L’article L.122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de suite est à la charge du vendeur et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
Dans le cadre de l’organisation de ventes aux enchères d’œuvres d’art organisée par Christie’s France, certaines de ces ventes donnent lieu à la perception d’un droit de suite. Or, les conditions générales de vente de Christie’s France prévoient que, pour certains lots désignés dans son catalogue, cette dernière perçoit de la part de l’acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, la somme correspondant au droit de suite.
Le Syndicat National des Antiquaires (SNA) estimant que les conditions générales de Christie’s France constituaient un acte de concurrence déloyale en mettant le droit de suite à la charge de l’acheteur a souhaité poursuivre Christie’s France en justice.
Pour sa part,Christie’s France considère que la Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, énonce sans autre précision ou restriction, que le droit de suite est à la charge du vendeur et qu’elle n’exclut donc pas un aménagement conventionnel de la charge du paiement de ce droit.
Saisie de ce litige, la Cour de cassation française demande à la Cour de justice si le vendeur supporte toujours définitivement le coût du droit de suite ou bien s’il est possible de déroger à cette règle par voie conventionnelle.
La CJUE, dans un arrêt C-41/14 « Christie’s France / SNC », répond que si la directive dispose que la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur, elle prévoit néanmoins une dérogation à ce principe et laisse ainsi les États membres libres de définir une autre personne parmi les professionnels visés dans la directive 2001/84.
La personne redevable du droit de suite ainsi désignée par la législation nationale est libre de convenir avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte en définitive, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
En tout état de cause, il convient de bien souligner que Christie’s France avait pris soin de noter que le paiement de la redevance du droit de suite était réglée « au nom et pour le compte du vendeur », instaurant ainsi un mandat afin de paiement, en toute transparence. Il paraît bien évidemment plus prudent de se placer sous la double bannière de cette question préjudicielle à la CJUE et du mandat afin d’être certain de profiter de l’aménagement organisé par la Directive 2001/84/CE.
Enfin, reste à savoir si le législateur profitera d’un nième lifting du CPI pour introduire cette exception au coeur de l’article L.122-8, exception qui semble définitivement acquise.

2014

La SGDL vous invite à sa conférence sur le nouveau contrat d’édition, le 13 janvier 2015 à l’Hôtel de Massa
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Comme nous l’avions commenté dans ce billet, le contrat d’édition a été assez substantiellement remanié.
La Société Des Gens de Lettres (SGDL), association reconnue d’utilité publique, ex-société de perception et de répartition de droits, souhaiterait communiquer autour du nouveau contrat d’édition, conforme aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur au 1er décembre 2014 et organise une rencontre d’information et d’échange sur ce nouveau contrat le 13 janvier 2015 à l’Hôtel de Massa.
Pour plus d’information :
SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
Hôtel de Massa
38, rue du Fbg-St-Jacques, 75014 Paris
tél : 01 53 10 12 00 fax : 01 53 10 12 12
www.sgdl.org – courriel : sgdl@sgdl.org

2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84.444, Publié au bulletin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029765817&fastReqId=1147696876&fastPos=1 Read More
2014

Le nouveau contrat d’édition et l’édition numérique
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le Code de la propriété intellectuelle vient de nouveau d’être mis à jour, par une Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition dont les contours, la forme et les conditions d’exploitation sont désormais mieux définies et ne relèveront plus de la seule appréciation du juge parfois différente d’une juridiction à l’autre.
Cet ajout législatif consiste notamment à intégrer la notion d’édition d’oeuvres par voie électronique en dessinant les contours de forme et de fond du contrat de cession de droits relatifs à ce type d’exploitation de l’oeuvre. L’ordonnance modifie donc certains des articles déjà existants et rajoute une sous-section 2 au livre I du Code de la propriété intellectuelle, par l’ajout de huit articles L. 132-17-1 à L. 132-17-8 .
1. Le contrat d’édition plus formaliste sur la cession de droit et la rémunération de l’auteur
Le contrat d’édition portant sur un ouvrage littéraire devra déterminer les conditions de la cession sur support papier et sur support numérique (« ebook » ou « livre numérique ») dans des parties distinctes, à peine de nullité de la cession.
Surtout, le nouvel article L. 132-17-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition garantit à l’auteur « une rémunération juste et équitable » sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, et qu’en cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes. Cela renvoie directement au mode de commercialisation de type e-book à l’unité, comme sur la plateforme iTunes par exemple.
Résolument moderne (on pouvait s’y attendre de la part du Pr. Sirinelli), le modèle économique reposant en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre est pris en compte et doit avoir un impact direct sur la rémunération due à l’auteur à ce titre. Ce mode de rémunération est donc clairement autorisé, ce dont certaines sociétés très en avance en la matière, telle Youboox et ses partenaires éditeurs, peuvent se féliciter.
Enfin la rémunération forfaitaire est exclue pour la cession de l’ensemble de ses droits d’exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d’exploitation numérique du livre, sauf dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, tels que mentionnés au 4o de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour une opération déterminée.
De manière non moins importante, l’article L. 132-17-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition doit comporter une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique, sans toutefois qu’une périodicité ou des conditions de déclenchement n’aient été introduites par le législateur… ce qu’on peut regretter car la mise en oeuvre d’une telle clause risque là encore de faire couler de l’encre jurisprudentielle.
2. Des obligations d’exploitation de l’oeuvre et de reddition des comptes renforcées
Le contrôle de la rémunération effective l’auteur et de l’exploitation effective de l’oeuvre sont désormais regardées de plus près en renforçant les obligations de l’éditeur.
Concernant la reddition des comptes, l’éditeur devra désormais procéder à une reddition des comptes au moins une fois par an, à la date prévue au contrat et au plus tard six mois après l’arrêté des comptes qui précède. A défaut, l’auteur disposera d’une faculté de résiliation du contrat, de plein droit.
De plus, concernant l’exploitation de l’oeuvre, l’auteur pourra également remettre en cause le contrat par voie de résiliation si, pendant deux années consécutives suivant les quatre premières années de la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître aucun droit versé ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations de vente sur support papier, vente à l’unité par voie numérique, consultation en ligne ou traduction intégrale.
Toutefois, le II. de l’article L.132-17-4 et l’article L. 132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle disposent qu’un accord entres organisations professionnelles et syndicats d’auteurs pourrait être rendu obligatoire par le Ministre chargé de la culture afin de déroger aux règles fixées par le I. de l’artice L.132-17-4 par la mise en place d’autres modalités concernant cette obligation d’exploitation de l’oeuvre.