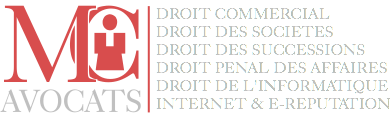2014

La marque, même tridimensionnelle n’a pas vocation à protéger un design
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Marque ou modèle, il faut choisir. C’est ainsi que l’avocat général Maciej Szpunar auprès de la CJUE a estimé que le droit de l’Union excluait tout enregistrement à titre de marque des formes imposées par la fonction du produit ainsi que les formes dont les caractéristiques esthétiques décident de l’attrait exercé par le produit.
En l’espèce, la société norvégienne Stokke A/S a déposé auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle une demande d’enregistrement pour une marque tridimensionnelle.
Cette marque reprend le dessin en trois dimensions (ou le design ou le modèle, selon l’expression préférée) de la chaise pour enfant « Tripp Trapp ».
De son côté, la société allemande Hauck GmbH & Co. KG produit et distribue des articles pour enfant, dont deux modèles de chaise nommés « Alpha » et « Beta ».
La société Stokke A/S et les deux auteurs personne physique du design industriel introduisent un recours contre la société Hauck, au motif que la vente des chaises « Alpha » et « Beta » viole leurs droits d’auteur ainsi que les droits tirés de la marque enregistrée par la société Stokke A/S.
La société Hauck forme une demande reconventionnelle, afin de l’annulation de la marque. En 2000, une juridiction néerlandaise accueille favorablement le recours des auteurs en ce qui concerne la violation des droits d’auteur tout en annulant, conformément à la demande de la société Hauck, l’enregistrement de la marque de la société Stokke A/S.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le « Hoge Raad der Nederlanden » (Cour suprême des Pays-Bas) pose à la CJUE des questions préjudicielles sur les motifs pour lesquels une marque constituée par la forme du produit peut être frappée de nullité.
C’est dans ce contexte que l’avocat général a estimé que la notion de « forme imposée par la nature même du produit », couvre non seulement les formes naturelles et les formes qui font l’objet de normes (comme par exemple la forme d’une banane pour les bananes ou bien celle d’un ballon de rugby), mais également d’autres formes, à savoir celles dont les caractéristiques essentielles résultent de la fonction du produit concerné. Il s’agirait par exemple, pour une table, de pieds accolés à un plateau horizontal ou, pour une brique, de la forme d’un parallélépipède.
L’avocat général considère également que le droit de l’Union exclut l’enregistrement d’une forme dont l’ensemble des caractéristiques essentielles sont conditionnées par la fonction utilitaire assurée par le produit. Réserver des caractéristiques revêtant une importance essentielle pour la fonction du produit au bénéfice d’un seul opérateur économique ferait obstacle à ce que des entreprises concurrentes attribuent à leurs produits une forme qui serait tout aussi utile à l’utilisation de ces derniers. Le propriétaire de la marque se verrait ainsi octroyer un avantage significatif qui aurait des effets négatifs sur la structure de la concurrence sur le marché concerné.
S’agissant du motif de refus ou de nullité basé sur les « formes qui donnent une valeur substantielle au produit », l’avocat général indique que le champ d’application de ce motif ne se limite pas aux œuvres d’art et aux œuvres des arts appliqués. Il concerne également les produits qui ne sont pas ordinairement perçus comme des objets assurant une fonction ornementale, mais pour lesquels l’aspect esthétique de la forme constitue l’un des éléments essentiels décidant de leur attractivité et joue un rôle important sur un certain segment défini du marché (comme c’est le cas pour les meubles de design). Partant, ce motif s’applique aux formes dont les caractéristiques esthétiques constituent une des raisons principales pour lesquelles le consommateur décide d’acheter le produit. Cette interprétation n’exclut pas que le produit présente d’autres caractéristiques importantes pour le consommateur.
Il semblait en effet utile de rappeler que les objets (les biens) matériels ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt de marque dans le sens où la forme de l’objet pourrait créer au bénéfice du déposant un monopole d’exploitation, ce qui n’est pas souhaitable.
En effet, la superposition du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles (du design autrement dit) protègent déjà suffisamment les objet tridimensionnels faisant l’objet d’une exploitation artisanale ou industrielle.
A ce titre, la logique de l’avocat général n’est pas sans rappeler les analyses faites quant au caractère propre qu’un dessin ou modèle doit conserver afin de conférer une protection efficace à l’objet auquel il se rapporte.
Enfin, les conclusions de l’avocat général doivent également être mises en lumière au regard du fait qu’une marque peut être renouvelée sans limite de temps… alors que le dessin ou modèle est limité à 25 ans d’existence que ce soit un dessin ou modèle français ou un dessin ou modèle européen.
L’aspect temporel du monopole conféré au titulaire de droit n’est donc pas neutre dans l’affaire et il aurait été bon d’y faire directement référence, car c’est aussi cela qui motive, sans nul doute, la position de l’avocat général… position qui, rappelons-le, n’engage pas la CJUE…
Attendons donc la solution.

2014

Un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur.
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur.
Une telle injonction et son exécution doivent toutefois assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux concernés.
La Cour estime dès lors que les droits fondamentaux concernés ne s’opposent pas à une telle injonction, à la double condition que les mesures prises par le fournisseur d’accès ne privent pas inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les
utilisateurs de consulter les objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
La Cour précise que les internautes ainsi d’ailleurs que le fournisseur d’accès à Internet doivent pouvoir faire valoir leurs droits devant le juge. Cette thèse était d’ailleurs déjà validée par la Cour d’appel de Paris, à l’initiative des avocats notamment de FREE, ORANGE, BOUYGUES et SFR.
Il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier si les conditions sus-citées sont bien remplies.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 mars 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Société de l’information – Directive 2001/29/CE –Site Internet mettant des œuvres cinématographiques à la disposition du public sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur – Article 8, paragraphe 3 – Notion d’ʻintermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisinʼ – Fournisseur d’accès à Internet – Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet – Mise en balance des droits fondamentaux»
Dans l’affaire C‑314/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 11 mai 2012, parvenue à la Cour le 29 juin 2012, dans la procédure
UPC Telekabel Wien GmbH
contre
Constantin Film Verleih GmbH,
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2013,
considérant les observations présentées:
– pour UPC Telekabel Wien GmbH, par Mes M. Bulgarini et T. Höhne, Rechtsanwälte,
– pour Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, par Mes A. Manak et N. Kraft, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans et C. Wissels, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. W. Bulst, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphes 1 et 2, sous b), et 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), ainsi que de certains droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UPC Telekabel Wien GmbH (ci-après «UPC Telekabel») à Constantin Film Verleih GmbH (ci-après «Constantin Film») et à Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ci-après «Wega») au sujet d’une demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de bloquer l’accès de ses clients à un site Internet mettant à la disposition du public certains des films de ces dernières sans leur consentement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9 et 59 de la directive 2001/29 énoncent:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. […] La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
[…]
(59) Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé. […] Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres.»
4 L’article 1er de ladite directive, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 1:
«La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.»
5 L’article 3 de la même directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», prévoit à son paragraphe 2:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement:
[…]
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;
[…]»
6 L’article 8 de la directive 2001/29, intitulé «Sanctions et voies de recours», indique à son paragraphe 3:
«Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.»
Le droit autrichien
7 L’article 18a, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiée par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-après l’«UrhG»), est libellé comme suit:
«L’auteur a le droit exclusif de mettre l’œuvre à la disposition du public, par fil ou sans fil, d’une manière qui permette à chacun d’y avoir accès de l’endroit et au moment de son choix.»
8 L’article 81, paragraphes 1 et 1a, de l’UrhG dispose:
«1. Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé ou qui redoute une telle violation peut engager une action en abstention. Le propriétaire d’une entreprise peut aussi être poursuivi en justice si la violation a été commise au cours de l’activité de son entreprise par l’un de ses employés ou par un mandataire ou si elle menace de l’être; l’article 81, paragraphe 1a, s’applique mutatis mutandis.
1a. Si l’auteur d’une telle atteinte ou la personne dont une telle atteinte est à craindre utilise à cette fin les services d’un intermédiaire, une action en abstention peut également être introduite contre ce dernier au titre du paragraphe 1. […]»
9 L’article 355, paragraphe 1, du code relatif aux procédures d’exécution dispose:
«La procédure d’exécution forcée à l’encontre de la personne tenue de cesser d’agir ou de tolérer un agissement prévoit que, pour chaque violation perpétrée après que l’obligation a acquis force exécutoire, le tribunal saisi de l’exécution, en accordant cette dernière, inflige, sur demande, une sanction pécuniaire. Pour chaque violation ultérieure, le tribunal saisi de l’exécution doit infliger, sur demande, une sanction pécuniaire supplémentaire ou une peine d’emprisonnement d’une durée totale d’un an maximum. […]»
10 Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle que, au stade de la procédure d’exécution forcée, le destinataire de l’interdiction peut faire valoir, pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat interdit.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Constantin Film et Wega, deux sociétés de production cinématographique, ayant constaté qu’un site Internet proposait, sans leur accord, soit de télécharger, soit de regarder en «streaming» certains des films qu’elles avaient produits, ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG, la délivrance d’une ordonnance enjoignant à UPC Telekabel, un fournisseur d’accès à Internet, de bloquer l’accès de ses clients au site Internet en cause, dans la mesure où ce site met à la disposition du public, sans leur consentement, des œuvres cinématographiques sur lesquelles elles détiennent un droit voisin du droit d’auteur.
12 Par ordonnance du 13 mai 2011, le Handelsgericht Wien (Autriche) a interdit à UPC Telekabel de fournir à ses clients l’accès au site Internet litigieux, cette interdiction devant être notamment réalisée en bloquant le nom de domaine et l’adresse IP («Internet Protocol») actuelle de ce site ainsi que toute autre adresse IP de ce dernier dont cette société pourrait avoir connaissance.
13 Au mois de juin 2011, le site Internet litigieux a cessé son activité à la suite d’une action des forces de police allemande à l’encontre de ses exploitants.
14 Par ordonnance du 27 octobre 2011, l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), en tant que juridiction d’appel, a partiellement réformé l’ordonnance de la juridiction de première instance en ce que celle-ci avait, à tort, spécifié les moyens qu’UPC Telekabel devait mettre en œuvre pour procéder au blocage du site Internet litigieux et ainsi exécuter l’ordonnance d’injonction. Pour parvenir à cette conclusion, l’Oberlandesgericht Wien a estimé que l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG doit être interprété à la lumière de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Puis, il a considéré que, en donnant accès à ses clients aux contenus mis en ligne illégalement, UPC Telekabel devait être considérée comme un intermédiaire dont les services étaient utilisés pour porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur de sorte que Constantin Film et Wega étaient en droit de demander à ce qu’une ordonnance soit prononcée contre cette société. Cependant, s’agissant de la protection du droit d’auteur, l’Oberlandesgericht Wien a estimé qu’UPC Telekabel pouvait uniquement se voir obligée, sous la forme d’une obligation de résultat, d’interdire à ses clients l’accès au site Internet litigieux, mais qu’elle devait rester libre de décider des moyens à mettre en œuvre.
15 UPC Telekabel a formé un pourvoi en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof (Autriche).
16 Au soutien de son pourvoi, UPC Telekabel fait notamment valoir que ses services ne pouvaient être considérés comme utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, car elle n’entretenait aucune relation commerciale avec les exploitants du site Internet litigieux et il n’est pas établi que ses propres clients ont agi de manière illégale. En tout état de cause, UPC Telekabel soutient que les différentes mesures de blocage susceptibles d’être mises en œuvre peuvent toutes être techniquement contournées et que certaines sont excessivement coûteuses.
17 Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 […] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui met des objets protégés à la disposition du public sur Internet sans l’autorisation du titulaire de droits [au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29] utilise les services du fournisseur d’accès [à Internet] des personnes qui consultent ces objets?
En cas de réponse négative à la première question:
2) Une reproduction effectuée pour un usage privé [au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire [au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29] ne sont-elles licites que si l’exemplaire servant à la reproduction a été reproduit, diffusé ou mis à la disposition du public en toute légalité?
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, c’est-à-dire dans le cas où une ordonnance judiciaire doit être rendue à l’encontre du fournisseur d’accès [à Internet] conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29:
3) Est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’interdire au fournisseur d’accès [à Internet] dans des termes très généraux (c’est-à-dire sans prescription de mesures concrètes) d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet dont l’intégralité ou une partie substantielle du contenu n’a pas été autorisée par le titulaire de droits, lorsque le fournisseur d’accès peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de cette interdiction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables?
En cas de réponse négative à la troisième question:
4) Est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’imposer à un fournisseur d’accès [à Internet] des mesures concrètes visant à rendre plus difficile à ses clients l’accès à un site Internet dont le contenu a été illégalement mis à disposition, lorsque ces mesures, qui requièrent des moyens non négligeables, peuvent facilement être contournées sans connaissances techniques spécifiques?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
18 À titre liminaire, il convient de relever que la circonstance selon laquelle le site Internet en cause au principal a cessé son activité ne rend pas les questions préjudicielles irrecevables.
19 En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, non encore publié au Recueil, point 34).
20 Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Aziz, précité, point 35).
21 Or, tel n’est pas le cas du litige au principal, puisqu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu du droit autrichien, la juridiction de renvoi doit rendre sa décision sur la base des faits tels qu’ils ont été exposés dans la décision de première instance, c’est-à-dire à un moment où le site Internet en cause au principal était encore accessible.
22 Il découle de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la première question
23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel serait à considérer comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l’affaire au principal, il est constant que des objets protégés ont été mis à la disposition des utilisateurs d’un site Internet sans le consentement des titulaires de droits évoqués audit article 3, paragraphe 2.
25 Vu que, selon cette disposition, les titulaires de droits jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire tout acte de mise à la disposition du public, il doit être constaté qu’un acte de mise à la disposition du public d’un objet protégé sur un site Internet effectué sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.
26 Pour remédier à une telle situation d’atteinte aux droits en question, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prévoit la possibilité, pour les titulaires de droits, de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à l’un de leurs droits.
27 En effet, ainsi que l’indique le considérant 59 de la directive 2001/29, dès lors que les services d’intermédiaires sont de plus en plus utilisés pour porter atteinte au droit d’auteur ou à des droits voisins, ces intermédiaires sont, dans de nombreux cas, les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.
28 En l’occurrence, le Handelsgericht Wien, puis l’Oberlandesgericht Wien ont enjoint à UPC Telekabel, fournisseur d’accès à Internet visé par l’injonction en cause au principal, de mettre fin à l’atteinte portée aux droits de Constantin Film et de Wega.
29 UPC Telekabel conteste toutefois pouvoir être qualifiée, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, d’intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
30 À cet égard, il découle du considérant 59 de la directive 2001/29 que le terme d’«intermédiaire», employé à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé.
31 Eu égard à l’objectif poursuivi par la directive 2001/29, tel qu’il ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, qui est de garantir aux titulaires de droits un niveau de protection élevé, la notion de contrefaçon ainsi employée doit être entendue comme incluant la situation d’un objet protégé mis sur Internet à la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits en question.
32 Par suite, vu que le fournisseur d’accès à Internet est un acteur obligé de toute transmission sur Internet d’une contrefaçon entre l’un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l’accès au réseau, il rend possible cette transmission (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, Rec. p. I‑1227, point 44), il y a lieu de considérer qu’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal, qui permet à ses clients d’accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers, est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
33 Une telle conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par la directive 2001/29. En effet, exclure les fournisseurs d’accès à Internet du champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 diminuerait substantiellement la protection des titulaires de droits, voulue par cette directive (voir, en ce sens, ordonnance LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, précitée, point 45).
34 Ladite conclusion ne saurait être remise en cause par l’objection selon laquelle, pour que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 soit applicable, il serait nécessaire qu’il existe un lien contractuel entre le fournisseur d’accès à Internet et la personne ayant commis l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
35 En effet, il ne ressort ni du libellé dudit article 8, paragraphe 3, ni d’aucune autre disposition de la directive 2001/29 qu’il serait exigé une relation particulière entre la personne qui porte atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin et l’intermédiaire. En outre, cette exigence ne saurait non plus être déduite des objectifs poursuivis par cette directive étant donné qu’admettre une telle exigence réduirait la protection juridique reconnue aux titulaires de droits en cause, alors que l’objectif de ladite directive, ainsi que cela ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, est précisément de leur garantir un niveau élevé de protection.
36 La conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 30 du présent arrêt n’est pas non plus infirmée par l’affirmation selon laquelle, pour obtenir que soit prononcée une injonction à l’encontre d’un fournisseur d’accès à Internet, les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin doivent démontrer que certains des clients dudit fournisseur consultent effectivement, sur le site Internet en cause, les objets protégés mis à la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits.
37 En effet, la directive 2001/29 exige que les mesures que les États membres ont l’obligation de prendre afin de se conformer à celle-ci aient pour objectifs non seulement de faire cesser les atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits voisins, mais également de les prévenir (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, Rec. p. I-11959, point 31, et du 16 février 2012, SABAM, C‑360/10, non encore publié au Recueil, point 29).
38 Or, un tel effet préventif suppose que les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin puissent agir sans devoir établir que les clients d’un fournisseur d’accès à Internet consultent effectivement les objets protégés mis à la disposition du public sans l’accord desdits titulaires.
39 Il en est d’autant plus ainsi que l’existence d’un acte de mise à disposition d’une œuvre au public suppose uniquement que ladite œuvre ait été mise à la disposition du public, sans qu’il soit déterminant que les personnes qui composent ce public aient ou non effectivement eu accès à cette œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I-11519, point 43).
40 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
Sur la deuxième question
41 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
42 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables.
43 À cet égard, ainsi que cela ressort du considérant 59 de la directive 2001/29, les modalités des injonctions que doivent prévoir les États membres en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national.
44 Cela étant, ces règles nationales, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent respecter les limitations découlant de la directive 2001/29 ainsi que des sources de droit auxquelles le considérant 3 de celle-ci fait référence (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 33 et jurisprudence citée).
45 Aux fins d’apprécier la conformité au droit de l’Union d’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il convient donc de tenir notamment compte des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, et ce conformément à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 41).
46 La Cour a déjà dit pour droit que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux États membres, lors de la transposition d’une directive, de veiller à se fonder sur une interprétation de celle-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables, protégés par l’ordre juridique de l’Union. Puis, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ladite directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, point 68).
47 En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, fait s’opposer, principalement, premièrement, les droits d’auteur et les droits voisins qui font partie du droit de propriété intellectuelle et sont dès lors protégés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, deuxièmement, la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès à Internet, en vertu de l’article 16 de la Charte, ainsi que, troisièmement, la liberté d’information des utilisateurs d’Internet, dont la protection est assurée par l’article 11 de la Charte.
48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.
52 D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité.
53 D’autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l’adoption de ladite injonction.
54 À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exécution qu’il a prises et avant qu’une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit.
55 Cela étant, lorsque le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures à adopter afin de s’y conformer, il doit veiller à respecter le droit fondamental des utilisateurs d’Internet à la liberté d’information.
56 À cet égard, les mesures qui sont adoptées par le fournisseur d’accès à Internet doivent être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à mettre fin à l’atteinte portée par un tiers au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d’accéder de façon licite à des informations s’en trouvent affectés. À défaut, l’ingérence dudit fournisseur dans la liberté d’information desdits utilisateurs s’avérerait injustifiée au regard de l’objectif poursuivi.
57 Les juridictions nationales doivent avoir la possibilité de vérifier que tel est le cas. Or, dans la situation d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que, si le fournisseur d’accès à Internet adopte des mesures qui lui permettent de réaliser l’interdiction prescrite, les juridictions nationales n’auront pas la possibilité d’effectuer un tel contrôle au stade de la procédure d’exécution, faute de contestation à ce sujet. Par suite, pour que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union ne s’opposent pas à l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il est nécessaire que les règles nationales de procédure prévoient la possibilité pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d’exécution prises par le fournisseur d’accès à Internet.
58 En ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle, il doit d’emblée être relevé qu’il n’est pas exclu que l’exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, n’aboutisse pas à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle des personnes intéressées.
59 En effet, d’une part, ainsi qu’il a été constaté, le destinataire d’une telle injonction a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité et ainsi de ne pas adopter certaines mesures éventuellement réalisables, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de raisonnables.
60 D’autre part, il n’est pas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n’existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d’une manière ou d’une autre.
61 Il y a lieu de relever qu’il ne ressort nullement de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte que le droit de propriété intellectuelle soit intangible et que, partant, sa protection doive nécessairement être assurée de manière absolue (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 43).
62 Cela étant, les mesures qui sont prises par le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, lors de l’exécution de celle-ci, doivent être suffisamment efficaces pour assurer une protection effective du droit fondamental en cause, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation dudit droit fondamental.
63 Par conséquent, bien que les mesures prises en exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles d’aboutir, le cas échéant, à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle, elles ne sauraient être considérées pour autant comme incompatibles avec l’exigence d’un juste équilibre à trouver, conformément à l’article 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, à condition cependant que, d’une part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, qu’elles aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.
Sur la quatrième question
65 Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
66 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
2) Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.
Signatures

2013

Le nom de domaine doit être distinctif pour assurer une protection et le NDD descriptif peut engager la responsabilité de son exploitant
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /C’est l’idée qui ressort des dernières jurisprudences en la matière : un nom de domaine ayant un caractère descriptif ne permet pas à son titulaire d’agir en concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise concurrente qui enregistrera le même nom de domaine ou un nom de domaine proche, même avec la même extension, visant le même territoire (voire la même localité).
Le nom de domaine descriptif ne confère aucun droit d’exclusivité et ne permet pas d’agir en concurrence déloyale
Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour d’appel de Bastia avait en effet déjà statué sur la question en retenant notamment que « en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer ’un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité. »
Il s’agissait, en l’espèce, d’un conflit intervenant entre le déposant du nom de domaine « mariagesencorse.com » et la déposante du nom de domaine « mariageencorse.com ».
Le premier déposant, s’imaginant sans doute que le premier arrivé est le premier servi et qu’il est forcément protégé juridiquement, estime être victime d’usurpation de son nom de domaine ’mariagesencorse.com’.
Il demande donc réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, estimant avoir subi une atteinte préjudiciable à son nom de domaine, constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme.
Le Tribunal de commerce d’Ajaccio, s’estimant compétent à tort pour juger de ce contentieux en droit des marques (même portant sur la question connexe des actes de concurrence déloyale), donne raison au demandeur.
La Cour d’appel de Bastia retient quant à elle qu’il n’y avait pas de ressemblance entre les deux sites concurrent et que le site « www.mariagesencorse.com est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet. »
La Cour en déduit très justement que le simple dépôt auprès d’un registrar d’un nom de domaine descriptif ne confère aucun droit, ni aucun monopole à son titulaire, lequel se voit privé, subséquemment, de toute action en concurrence déloyale contre des sites internet ayant la même activités, même sur le même territoire et usant d’un signe descriptif très proche voire identique à titre de nom de domaine.
Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 24 mai 2013 a retenu une solution similaire à l’occasion d’un contentieux opposant les titulaires des noms de domaines « e-obseques.fr » et« i-obseques-paris.fr », le premier appartenant à une société privée et son gérant, demandeurs à l’instance, et l’autre à la ville de Paris, défenderesse.
Le Tribunal de commerce, à l’instar de la Cour d’appel de Bastia, retient également que la société privée et son gérant « ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif », outre le fait que les demandeurs « ne sont pas en mesure d’établir qu’une quelconque confusion soit possible entre le graphisme de leur site et celui de la société ».
Cette idée a d’ailleurs pour origine le fait que pour avoir une marque forte et qui pale d’elle même, il faut choisir un signe lequel, par définition, doit permettre de se distinguer des concurrents et non de se confondre avec.
Les critères permettant d’agir en concurrence déloyale au titre du plagiat d’un site internet
On notera, à ce titre, que ces solutions rejoignent celles déjà adoptées par le Tribunal de grande instance de Paris qui retient usuellement que l’imitation des fonctionnalités et la reproduction quasi-servile des conditions générales d’utilisation d’un site internet sont constitutives d’actes de concurrence déloyale (TGI, 3ème civile, 2ème Section, 15 mars 2013).
La solution de bon sens donne par conséquent une idée précise de ce que doit désormais relever l’exploitant d’un site internet pour poursuivre en concurrence déloyale un site concurrent :
– L’imitation d’un signe distinctif éventuellement déposé à titre de marque, de dénomination sociale et/ou de nom commercial ;
et/ou
– L’imitation d’un graphisme et/ou des fonctionnalités / conditions générales d’utilisation.
Ces critères ne sont pas nécessairement limitatifs, mais en l’absence de contrefaçon d’éléments de propriété intellectuelle, ils doivent servir de référence de base avant d’agir en concurrence déloyale contre un site internet concurrent.
Exploiter un nom de domaine descriptif peut être un acte de concurrence déloyale
Pour aller plus loin, rappelons que la Cour de cassation avait retenu, dans un arrêt du 04 mai 2012, que le fait (pour un avocat) d’enregistrer un signe descriptif à titre de nom de domaine (« avocat-divorce.com », en l’espèce) constituait « une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale » (Cass. Civ. 1ère, 4 mai 2012, N° de pourvoi: 11-11180, publié sur Legifrance).
Le problème était par conséquent carrément inversé : c’est le déposant d’un nom de domaine descriptif qui aurait pu être attaqué pour concurrence déloyale par ses concurrents, non titulaires du même nom de domaine.
Certes cette jurisprudence s’applique à une profession réglementée (avocats)… néanmoins, l’argument, souligné par la Cour de cassation, consistant à soutenir qu’il y a concurrence déloyale du fait de l’enregistrement d’un nom de domaine descriptif est, à nos yeux, une invitation à ouvrir droit à poursuites à tout concurrent !
Contrairement à ce qu’on peut écrire faussement certains avocats, il n’est donc surtout pas question de course au référencement : au contraire, les noms de domaines génériques sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur déposant et/ou de leur exploitant.
En effet, une telle jurisprudence dénote clairement une hostilité certaine de la haute juridiction à l’égard des signes descriptifs enregistrés à titre de nom de domaine.
Peut être que certains professionnels y verront une opportunité pour faire cesser des agissements de concurrents peu scrupuleux qui achètent des noms de domaines descriptifs à tour de bras pour « occuper l’espace » et acquérir de la visibilité.
Il se pourrait que le mouvement jurisprudentiel de ces derniers mois leur offre, en effet, une voie d’action.
Et ce serait logique puisqu’en droit des marques, tout intéressé peut invoquer à titre de moyen en défense la nullité d’un signe descriptif : il y a donc une certaine logique à neutraliser toute forme de monopole, quel qu’il soit, y compris s’agissant d’un nom de domaine descriptif quant à l’activité auquel il se rapporte.
En sus, cette hostilité rejoint la nouvelle (quoique de moins en moins « nouvelle ») politique de référencement de Google qui ne souhaite plus donner la part belle aux noms de domaine descriptifs, précisément afin d’éviter des abus en matière de référencement.
Il semble donc que l’achat de nom de domaines descriptifs pour être « bien vus » sur le net risque d’être « mal vus », non seulement par Google, mais également désormais, par les juridictions françaises.

2012

Cyber-harcèlement et e-réputation : vade-mecum
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La publication de contenus sur internet est devenue tellement facile qu’il n’existe plus de profil type du « cyber-harceleur ». Tout le monde peut être victime de cyber-harcèlement.
Toutefois, retrouver, sur internet, des photos ou des vidéos de soi, publiées par un « ex » ou par un tiers mal intentionné, n’est pas une fatalité insurmontable.
De même, diffamations et injures postées sur un blog peuvent être effacées, si l’on sait s’y prendre.
Nous vous proposons ici un vade-mecum des situations de cyber-harcèlement et des solutions existant pour nettoyer sa e-réputation et faire disparaitre des photos ou des vidéos intimes, des textes diffamants, injurieux et/ou dénigrants.
Il est même possible de retrouver et de poursuivre la personne ayant publié les contenus litigieux sur internet (même si certains croient parfois à tort qu’un pseudo leur confère anonymat et impunité).
La « e-réputation » se définit comme toute information disponible sur internet concernant une personne physique ou une entreprise.
Le « cyber-harcèlement » consiste à publier de manière répétée dans le temps et/ou sur un grand nombre de sites internet, des informations destinées à salir la e-réputation une personne physique ou morale.
A l’origine du mal, on notera toujours les mêmes (res)sentiments humains menant au délit : jalousie, rancune, racisme, sexisme, homophobie ou plus simplement un mécontentement.
Le plus souvent, les auteurs de cyber-harcèlement sont un ancien salarié, un ex-conjoint, un concurrent, un client mécontent, ou plus simplement un autre internaute croisé sur un réseau social, un site de rencontre ou un blog…
On retrouve même des <a href= »http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ce-que-le-harcelement/le-cyberharcelement/ »>victimes de cyber-harcèlement dans les écoles</a> et les conséquences peuvent aller, dans des cas extrêmes, jusqu’à la tentative de suicide.
Le mode d’expression choisi est souvent le même et il se traduit par la publication sur internet d’un texte diffamant, injurieux ou dénigrant ; d’images relevant de la vie privée, parfois très intimes et dénudées…
Or, si chacun jouit d’une liberté d’expression, garantie par des textes constitutionnels, cette liberté connait certaines limites, à savoir notamment les droits et libertés de ceux qui pourront être visés par la publication internet litigieuse.
Il existe deux grands types d’atteintes qui constituent précisément ces limites à la liberté d’expression : les atteintes à l’honneur et à la réputation, et les atteintes à la vie privée.
Sur internet, injure et diffamation sont parmi les atteintes les plus fréquentes.
Les atteintes à l’honneur et à la réputation sont précisément encadrées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment aux articles concernant la diffamation et l’injure, lesquelles sont les atteintes (fautes pénales et quasi-délictuelles) les plus courantes en matière de e-réputation.
A noter : en matière de diffamation et d’injure, la loi sur la presse de 1881 est applicable aux délits commis sur internet.
Comme d’autres auteurs et praticiens, j’ai apporté une contribution très critique à ce propos, mais le régime juridique n’a pas encore évolué (voir mon article à propos du <a href= »http://www.cordelier-avocat.fr/news.php?id=regime-prescription-presse-internet »>régime contestable de la prescription des délits de presse sur internet</a>).
Il faut impérativement distinguer injure et diffamation.
La diffamation est une fausse accusation portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
L’injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective sans accusation précise.
Par exemple, qualifier quelqu’un « d’escroc », implique que l’on accuse une personne d’avoir commis des faits relevant d’un délit d’escroquerie. C’est donc une diffamation.
A l’inverse, les noms d’oiseaux et les termes ayant vocation à outrager, sans se référer à des faits ou des infractions précises sont des injures.
Par exemple, des expressions telles que « bandit » ou « voyou », dès lors que ces expressions ne sont pas liées à des faits précis, sont des injures.
A ce titre, il convient de souligner que la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt de principe en date du mois dernier (C.cass. ass. plén. 15 fév. 2013, n°11-14.637), que la qualification entre injure et diffamation n’est pas cumulative et que chaque imputation doit faire l’objet d’une qualification précise.
Par conséquent, une injure n’est pas une diffamation et réciproquement, et on ne peut pas poursuivre l’auteur de la publication pour les deux qualifications simultanément concernant les mêmes propos.
Cet arrêt réaffirme la constante position de la Cour de cassation en matière de défense de la liberté d’expression et du respect des droits de la défense. Il démontre également que la recherche de la qualification juridique entre « injure » et « diffamation » relève d’une appréciation parfois complexe à départager.
La diffusion de photos et de vidéos est l’atteinte à la vie privée la plus fréquente.
Pour simplifier, l’atteinte à la vie privée est le fait de publier une photographie, une vidéo ou tout autre élément permettant d’identifier une personne physique sans y avoir été autorisé préalablement.
D’autres critères, tel un lieu privé ou public, ou la vie publique d’une personnalité peuvent jouer sur le caractère « privé » de ces éléments.
Les deux exemples les plus récurrents sur internet sont la publication de photos/vidéos volées (ou de clichés ou vidéos pris par l’auteur mais divulgués sans autorisation du sujet) et la publication de données d’identification ou de coordonnées privées (adresse, numéro de téléphone, etc.)
Dans la mesure où de telles publications sont répétées dans le temps et sur différents sites internet, on peut dès lors parler de <b> »cyber-harcèlement »</b>, quoique cette expression n’ait pas (encore) reçu d’écho jurisprudentiel.
La situation est malheureusement très fréquente et elle touche souvent des personnes après une rupture avec un ex-compagnon, amant ou conjoint (le féminin est ici grammatical, quoique statistiquement, les victimes sont très majoritairement des femmes).
En cas d’atteinte à la vie privée, de diffamation ou d’injure, il faut agir vite.
Si la priorité est donnée à la suppression du contenu, il faut immédiatement demander la suppression du message, de la vidéo ou de la photo.
Si la priorité est donnée à la poursuite judiciaire de l’auteur, il faut avant tout commencer par un constat d’huissier.
Le constat d’huissier est important, car c’est le premier acte que demande un avocat pour prouver les préjudices de la victime.
Ce constat d’huissier doit notamment démontrer : la matérialité des faits (la réalité des faits), leur date, et l’étendue du préjudice (le nombre de sites où la publication figure et/ou le nombre et le positionnement des résultats dans les moteurs de recherche).
Des délais courts pour agir contre une diffamation ou une injure.
Le premier réflexe est de chercher à savoir si les délais pour agir en justice ne sont pas dépassés.
Malheureusement, comme je l’expliquais dans mon article sur la prescription des délits de presse sur internet, de nombreuses victimes découvrent les textes diffamants ou injurieux beaucoup trop tard, parfois six ou huit mois, voire plusieurs années après leur date de publication.
Or, concernant la diffamation et l’injure, un délai de trois (3) mois court à compter de la première publication des propos litigieux pour saisir la justice.
Pire, ce délai continue de courir après chaque acte judiciaire de sorte qu’il faut en quelque sorte « maintenir en vie » le procès, comme on le ferait avec un malade sous assistance respiratoire.
C’est à peu près la seule procédure qui est dotée d’un régime de prescription aussi court et marquant autant la procédure (civile ou pénale).
En matière d’injure et de diffamation, il convient donc d’être très rapide pour agir.
Pour ce faire, il est recommandé aux professionnels exposés de recourir à un service de veille.
S’agissant des personnes physiques ne souhaitant pas mobiliser un budget pour cela, de simples recherches périodiques dans les principaux moteurs de recherche internet peuvent suffire à leur donner une idée de l’évolution de leur e-reputation.
Ainsi, « s’auto-googliser » ne relève pas du simple effet de mode : c’est un bienfait d’intérêt personnel aussi important que d’aller chez le dentiste pour un check-up.
S’agissant des autres atteintes non couvertes par le droit de la presse (par exemple, les atteintes à la vie privée), les prescriptions sont beaucoup plus longues : elles vont de 3 ans pour les délits jusqu’à 5 ans désormais pour les autres actions en responsabilité civile.
N.B. : pour toutes publications datées du 17 juin 2003 au 17 juin 2008, il faut bien prendre en considération que le délai de prescription, jadis de 10 ans en matière de responsabilité civile délictuelle, a désormais pour date butoir la date du 17 juin 2013 (LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile).
La lutte contre le cyber-harcèlement passe d’abord par un courrier de mise en demeure systématique.
Pour nettoyer son e-reputation, il n’est pas forcément nécessaire d’agir en justice.
En premier lieu, on peut utiliser les différents niveaux « d’alerte » existant parfois sur certains sites.
Ces « alertes » consistent en : 1) un « signalement » d’un contenu offensant à l’autorité de modération de l’éditeur du site internet concerné et/ou ; 2) une procédure de « plainte » interne au site internet concerné.
La difficulté est que ces procédures, sur certains sites internet, ne sont pas forcément fournies avec des explications en français. Ces procédures sont parfois extrêmement formalistes et rigoureuses, aboutissant souvent à une fin de non recevoir.
En outre, certaines qualifications juridiques existant en France ne sont pas toujours répertoriées.
En deuxième lieu, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») organise une procédure de notification de demande de retrait de contenu applicable aux hébergeurs.
Cette procédure permet de solliciter le retrait d’une information litigieuse, par courrier A.R. revêtant certaines formes précises prévues par ladite loi.
A ce titre, il convient de souligner que la notification d’une demande de retrait est assez formelle et qu’elle répond à des critères précis. Il faut donc manier les faits et les qualifications juridiques avec justesse pour obtenir gain de cause.
En cas de refus de suppression du contenu, la responsabilité de l’hébergeur peut être recherchée, sous réserve qu’on puisse démontrer que la publication litigieuse est bien attentatoire à un droit, et que ledit hébergeur en a été correctement informé de cette atteinte.
En troisième lieu, il est possible, sous l’empire de la même loi, de solliciter la suppression de la publication litigieuse par requête formulée auprès du juge, sans procédure contradictoire contre l’auteur du contenu litigieux dont l’identification n’est pas toujours possible (pour des raisons techniques que je n’expliquerais pas).
Toutefois, il convient de souligner que l’appréciation de la demande de retrait « judiciaire » est soumise à l’appréciation souveraine des juges.
En quatrième lieu, sous réserve que les délais de prescription le permettent, il est possible d’agir en référé (procédure d’urgence) afin de faire cesser les atteintes.
Cette procédure est rapide, mais elle ne permet d’agir qu’en cas d’urgence et d’évidence, afin de faire cesser un trouble, éventuellement sous astreinte journalière, ainsi que d’obtenir, sous certaines conditions, une provision sur les dommages intérêts à demander dans le cadre d’une procédure normale (dite procédure « au fond »).
<b>Enfin, en dernier lieu</b>, le dernier recours est d’agir au fond, c’est à dire au sein d’une procédure judiciaire classique devant un Tribunal statuant sur une demande de dommages-intérêts ou d’autre type de réparation.
Selon les cas, on peut préférer la voie de l’assignation devant un tribunal civil ou la citation directe devant un tribunal correctionnel.
Dans le cadre de l’assignation, on peut demander tous types de réparation, dont des dommages-intérêts et éventuellement une mesure de publication judiciaire du jugement ou d’un extrait du jugement, lorsque ce type de mesure participe à la réparation des dommages.
Dans le cas de la citation directe, il faut être particulièrement délicat dans la rédaction de l’acte de procédure pénal sur lequel s’appuiera le Procureur de la République pour asseoir son réquisitoire (ce qui signifie que si les faits sont mal qualifiés, le Procureur risque fort de requérir… la relaxe !).
De même, une plainte peut être déposée auprès du Procureur de la République, si les faits relèvent bien d’une infraction pénale.
A noter, toutefois, que l’accroissement constant du nombre de délits sur internet encombrent particulièrement les Parquets et que les Procureurs choisissent bien évidemment de poursuivre les dossiers les plus graves.
La lutte contre le cyber-harcèlement doit combiner des actions juridiques et des actions techniques.
Il existe de nombreuses sociétés proposant des services dits d’amélioration de son « e-réputation ».
Parmi elles, seules certaines se sont adossées aux services d’un avocat connaissant bien les problématiques de l’internet.
D’autres sont des sociétés commerciales qui vendent uniquement des services de référencement (mais un référencement « à l’envers » qu’on désigne sous le terme « d’enfouissement ») sans aucune valeur ajoutée juridique.
En effet, ces sociétés seules ne peuvent pas proposer d’agir en justice contre des éditeurs ou des hébergeurs de sites internet où figurent les publications litigieuses.
Or, il faut être clair : il ne suffit pas de pousser la saleté « sous le tapis » pour nettoyer son e-reputation ! Il convient de mener concomitamment des actions juridiques.
Malgré cela, de nombreuses sociétés, dont les plus connues, proposent donc – par défaut – des solutions de « maquillage » consistant à se limiter à tenter de reléguer en page 2 ou 3 les contenus indésirables dans les pages de résultats des moteurs de recherche… mais, dans la plupart des cas, ces contenus ne sont pas effacés !
A l’inverse, l’alliance entre une agence d’e-réputation et un avocat est synergique :
– l’agence assurant la veille et la recherche de contenus peut vérifier, grâce à des outils informatiques, l’étendue exacte des atteintes (notamment si elles sont répétées sur plusieurs sites) ;
– l’avocat assure la qualification juridique des faits et donne les premières indications quant aux voies de recours, leurs coûts et leurs délais ;
– s’agissant des envois de demande de retrait, un partage des tâches peut être opéré, avec l’accord du client, entre l’avocat et l’agence en e-réputation pour minimiser les coûts de traitement ;
– enfin, c’est seulement à défaut de pouvoir effacer les contenus juridiquement que l’agence en e-réputation participe à l’enfouissement des publications dont le retrait s’avère parfois problématique, même avec une procédure judiciaire.
C’est donc la combinaison d’actions techniques et d’actions juridiques, voire judiciaires, qui assure l’efficacité de mesures de nettoyage d’une e-réputation.
Dans tous les cas, la mise en oeuvre de ces actions n’a pas forcément un effet immédiat, même si on note, le plus souvent, une forte réactivité des hébergeurs face à une notification juridiquement bien motivée afin du retrait d’un contenu litigieux.
La protection de l’e-réputation est désormais une préoccupation intéressant tant les particuliers que les professionnels.

2009

Noms de domaine, marques et site-parking : quelle antériorité ? quelle responsabilité ?
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Depuis que les stratégies de référencement et d’accroissement de trafic à des fins publicitaires sont connues des acteurs de l’internet, on a vu tour à tour différentes méthodes d’exploitation des noms de domaines prospérer… parfois au détriment de tiers.
Sans que la liste se veuille exhaustive on dénombre parmi ces méthodes deux des plus connues :
- Le « cyber-squatting » (détention et/ou exploitation frauduleuse d’un nom de domaine homonyme de la marque et/ou du nom de domaine antérieurs d’un tiers) ;
- Le « site-parking » (enregistrement d’un nom de domaine redirigé – le plus souvent via un « redirect 301 » – vers une page contenant des liens publicitaires).
Si les actes de cyber-squatting sont désormais bien connus et facilement condamnés par les tribunaux, y compris par voie de référé, la condamnation de regristrars ou détenteurs de site-parking commence tout juste à rentrer dans les moeurs de nos juridictions.
Dans une affaire opposant le propriétaire d’une marque à la fois au registrar dudit Nom De Domaine et au titulaire du NDD litigieux la Cour de Cassation a pu retenir que le registrar, en ayant placé des liens commerciaux par redirection de l’url acquise par son client ne pouvait pas être qualifié de simple intermédiaire technique assurant le stockage de contenu, au sens de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN).
Par voie de conséquence, la Cour a conclu que le registrar ne pouvait échapper à sa responsabilité d’éditeur étant entendu que « les principes de loyauté et de libre concurrence attachés à l’exercice de toute activité commerciale imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique« .
LA RESPONSABILITE DES REGISTRAR EN MATIERE DE SITES-PARKINGS PUBLICITAIRES
Ce raisonnement démontre que (en une pierre, deux coups) à la fois le titulaire d’un nom de domaine acquis en fraude des droits d’un tiers pouvait être condamné à transférer ledit nom au titulaire de la marque ou du nom de domaine antérieur…
… et que le registrar, dès lors qu’il recourt à la solution du site-parking (prétendument dans l’intérêt de l’accroissement de la valeur commerciale et de la qualité du référencement du nom de domaine de son client) se rend, par cet acte, lui-même éditeur et donc responsable du contenu diffusé… parfois à l’insu de son client le temps que la redirection mise en place soit écrasée par l’édition d’un site ou par la mise en place d’une autre redirection commandée, cette fois, par le titulaire du nom de domaine.
Mais, si l’on exclue l’atteinte au droit d’un tiers, le recours au site-parking a d’autres conséquences notamment dans la relation registrar – titulaire de nom de domaine.
S’il on peut concevoir que le titulaire du nom de domaine récemment acquis et son registrar sont responsables des atteintes commises aux droits des tiers, qu’en est-il de l’atteinte commise par le registrar aux droits de son propre client ?
Le fait que le client ait adhéré à des conditions générales de ventes le prive-t-il de tout recours contre le registrar qui aura agit ainsi et créé un préjudice audit client, notamment au regard de la concurrence déloyale ?
Pour simplifier les choses, le seul titulaire du nom de domaine est celui au profit duquel l’enregistrement du nom a été validé.
Or, le registrar qui met en place, même par défaut, une redirection du nom de domaine pointant sur un site hébergeant des publicités (quasi-systématiquement très ciblées par rapport à l’intitulé du nom) va profiter directement au registrar lui-même et non au titulaire du nom de domaine.
En effet, les revenus acquis au titre des liens publicitaires en rapport avec l’intitulé du nom de domaine litigieux ne profitent pas au titulaire du nom de domaine, mais bien au registrar.
Cela pourrait caractériser un acte de concurrence déloyale au détriment du client titulaire du nom de domaine.
Toutefois, on peut s’interroger sur le sort d’une éventuelle responsabilité du registrar vis-à-vis de son client, notamment lorsque la faculté de recourir à une redirection est expressément prévue au contrat.
Cependant, il paraît difficile de concevoir que le registrar (souvent également hébergeur) puisse valablement encaisser des revenus publicitaires sans offrir de compensation à son client…
LA PROBLEMATIQUE DE L’EXPLOITATION DU NDD
Reste à savoir si un nom de domaine en site-parking peut être valablement considéré comme exploité.
Or, dès lors que l’on considère que la page publicitaire est éditée par le registrar, et non par le titulaire du nom de domaine, il apparaît difficile de considérer qu’il pourrait valablement y avoir exploitation dudit NDD.
La question trouverait-elle une réponse différente si c’est le titulaire qui exploite un page de publicité ?
La réponse est plus incertaine, car le NDD est bien utilisé à des fins commerciales…
… mais pour répondre totalement à cette question, il convient alors de s’attacher au fait de savoir si, comme le retient la jurisprudence en matière de droit des marques, l’usage fait du nom est un usage sérieux, en rapport avec les produits ou services considérés entre les deux signes (conflit de marque et de nom de domaine ou noms de domaine en conflit entre eux) dont l’antériorité est remise en cause.
L’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.

2005

Choisir une marque : difficultés et risques
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le dépôt d’une marque ou le choix d’un nom de société est moins aisé qu’il ne le paraît. La multitude des noms coexistants, la complexité du choix des classes de produits et services, les difficultés du choix stratégique entre un dépôt et une acquisition de marque ou de nom de domaine… sont autant de difficultés qui poussent de plus en plus de déposants à recourir aux services d’avocats pour effectuer les recherches, les dépôts ou négocier un accord de coexistence de marque.
S’ajoute à cette tendance le fait que les risques juridiques et financiers encourus (action en contrefaçon indemnitaire et demande d’annulation ou de transfert de marque, le plus souvent sous astreinte), peuvent être une source de graves problèmes pour l’entreprise, quelqu’en soit la taille (groupes, PME, voire artisans ou commerçants individuels).
A ce jour, le contentieux en droit des marques est chaque jour plus important, quelques soit les tailles et le niveau respectif des entreprises concurrentes (et parfois vaguement concurrentes en raison d’une marque notoire). Ce phénomène concerne également les litiges impliquant : marque contre nom de domaine ; marque contre dénomination sociale ou contre nom commercial ; nom de domaine contre dénomination sociale ou nom commercial.
Pour prévenir ce type de contentieux contre une signe antérieure, il est donc fortement recommandé aux futurs déposants de consulter un avocat qui effectuera, à leur place, recherches et dépôt, et vous avisera sur les difficultés rencontrées et les solutions à y apporter (accord de coexistence de marque, acquisition de marque, action en déchéance de marque inutilisée…).
En tout état de cause, un avocat peut accompagner le déposant, avant le dépôt de sa marque, pour l’étape qui lui conviendra et l’aider, le cas échéant, à trouver une solution économiquement sûre.
Toutefois, un petit guide en trois étapes simple, peut permettre au déposant qui a choisi de se passer d’avocat de se rendre compte de la facilité ou de la difficulté de demander, seul et de son propre chef, l’enregistrement du nom qu’il a choisi à titre de marque.
Voici ce guide :
1. Avant toute chose, commencer par l’élémentaire : en fonction des activités potentiellement couvertes par la marque future, il convient de déterminer les produits et/ou services concernés.
Pour bien délimiter le champ de ces produits et services, le déposant devra passer en revue l’ensemble des points abordés dans son plan marketing, et notamment toutes les activités envisagées, à titre principal ou à titre secondaire.
Par exemple, si le déposant crée une entreprise de services informatiques, quels sont les services envisagés (logiciels, multimédia, création vidéo numérique, etc.) ? et sera-t-il amené (même potentiellement) à distribuer des produits, y compris à titre d’accessoires (DVD, supports de mémoire flash, etc.) ?
Pour aider les déposants dans ce choix stratégique, une nomenclature des classes de produits et services est disponible sur le site internet de l’INPI.
2. Après cette définition précise du « contenu » de la marque, il convient de s’intéresser à son « emballage » et donc à la disponibilité du nom envisagé.
En effet, les marques antérieures (c’est à dire : déjà existantes, au moment de la demande d’enregistrement faite par le déposant) ne peuvent être contrefaites, ni de manière servile, ni de manière approximative, dès lors qu’il y a une ressemblance entes les deux noms et une coïncidence de classes de produits et services.
Pour bien effectuer une recherche en antériorité, plusieurs méthodes doivent être envisagées en procédant par une méthode imitant le système de l’entonnoir : partir du plus large et approximatif, pour arriver au plus précis et pertinent.
La comparaison porte à la fois sur le nom littéral de la marque et, dans une moindre mesure, sur sa forme, ses couleurs, son apparence, s’il y a lieu.
Il convient de bien souligner qu’en cette matière, les différences comptent moins que la ressemblance générale des noms concurrents. Et, cette ressemblance peut entraîner l’annulation du dépôt le plus récent au profit de la marque bénéficiant de l’antériorité.
La marque est un signe distinctif, pas un moyen d’imiter le concurrent, ni de près, ni de loin.
3. Une fois toutes les vérifications effectuées, il convient de remplir le formulaire de dépôt, avec une représentation graphique (ou non) de la marque et la listes des classes de produits et services visés.
Le déposant pourra alors préciser les classes de produits visés en excluant ceux qui pourraient déjà être occupés par une marque concurrente et ressemblante.
Il ne reste plus qu’à déposer et payer les droits d’enregistrement dont les tarifs sont disponibles sur le site de l’INPI.