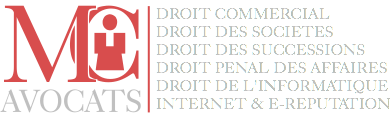2015

E-réputation : 4 leçons à retenir concernant le nettoyage judiciaire d’avis négatifs pour 2015/2016
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Toutes les entreprises sont visées par des avis négatifs sur internet, et pas seulement les hôtels qui sont en outre confrontés à des avis de clients effectifs, sur des portails tels que Hotels.com, Booking ou Tripadvisor, à l’inverse de nombreux autres sites hébergeant des avis d’internautes. Ces avis sont pourtant souvent moins contrôlés, excessifs voire parfois totalement diffamatoires ou dénigrants pour l’entreprise. Il n’est pas impossible de réagir à et de nettoyer des avis négatifs, mais la tâche est devenue plus difficile en 2015 qu’auparavant : la loi n’a pourtant pas changé ; c’est le contrôle du juge des requêtes qui s’est resserré. Voici les 5 leçons à retenir dans ce nouveau contexte.
1. L’effacement à première demande doit prendre la forme d’une notification LCEN.
Bien entendu, les entreprises peuvent faire le choix de recourir d’abord à une solution amiable, en utilisant les outils de « plainte » ou de « modération » présents sur de nombreux portails, ou en passant par l’administrateur du site, avec des chances de succès parfois très approximatives (mais dans certains cas cela fonctionne, il ne faut donc pas s’en priver) pour demander la suppression de l’avis.
A défaut, il convient avant toute démarche judiciaire, d’adresser une mise en demeure mise en forme selon les prescriptions de l’article 6 de la LCEN. C’est indispensable, et le juge exigera que cette démarche soit accomplie avant qu’on viennent le saisir, car le principe de cet article de loi est que la personne s’estimant victime d’un avis négatif ou d’un faux avis sur internet doit d’abord saisir l’hébergeur d’une demande de retrait de cet avis négatif, de manière formelle.
2. Lors d’une première requête, le juge n’ordonnera l’effacement que des contenus d’une particulière gravité
C’est cela qui a changé : la lecture de l’article 6 de la LCEN permettait, il n’y a pas si longtemps, d’obtenir l’effacement d’un avis négatif dès lors qu’on démontrait le caractère illicite de l’avis négatif litigieux, un préjudice à faire cesser, et le refus de l’hébergeur de supprimer l’avis au mépris de la LCEN.
Aujourd’hui, en remettant la protection de la liberté d’expression en avant, le juge refuse d’effacer un avis négatif, même clairement dénigrant, diffamant ou injurieux, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’auteur du message litigieux n’est pas identifiable.
3. La condition d’effacement des contenus après l’échec d’identification de l’internaute : une procédure plus longue
L’effacement de l’avis négatif pourra donc avoir lieu : sur requête, s’il est rapporté la preuve que l’auteur de l’avis litigieux n’est pas identifiable, ou par voie d’une action au fond (action en diffamation, injure ou responsabilité civile) s’il s’avère qu’une identification a été rendue possible.
Il est bien évident que de soumettre l’effacement d’un avis négatif à la condition que soit rapportée la preuve de l’impossibilité de son identification rallonge considérablement les délais permettant d’introduire une procédure, ce qui a un impact sur le choix du procès au fond à intenter si l’auteur de l’avis négatif est identifié.
4. Pour l’action au fond, préférer l’action en dénigrement à l’action en diffamation
Bien souvent, lorsqu’on obtient l’identification de l’auteur, il est trop tard pour agir sur le terrain du droit de la presse (c’est à dire, essentiellement, pour cause de diffamation ou d’injure, s’agissant d’avis négatifs sur des produits ou services d’entreprises), puisque le délai de prescription n’est que de 3 mois à compter de la première publication du message litigieux.
De plus, l’action en diffamation suppose de rapporter la preuve du caractère erroné / faux du texte de l’avis négatif, de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de l’entreprise, tout en s’affranchissant du risque de rapport de preuves de vérité par l’auteur des propos.
A l’inverse, dans un procès en dénigrement, fondé sur l’article 1382 du Code civil, il suffit que l’avis négatif porte atteinte à l’image de l’entreprise, afin de détournement de clientèle, en usant de critiques, mêmes exactes, à l’encontre d’un produit ou service désigné ou identifiable, peu important que le message soit publié par une personne concurrente ou non l’entreprise visée. De plus, l’action en dénigrement se prescrit par 5 ans : elles est donc plus facile à mettre en oeuvre qu’une action en diffamation.

2015

Piratage informatique : vers une nouvelle définition du vol de fichiers informatiques ?
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Dans un arrêt du 20 mai 2015 (publié au bulletin), la Cour de cassation vient de préciser la définition de la fraude informatique en retenant qu’il suffit que le pirate ait eu connaissance de la présence d’un système de protection (par identifiant et mot de passe) pour que soit retenu le délit de piratage informatique… même si ledit système de protection a été « contourné » par la simple utilisation d’un moteur de recherche internet. Etrange.
On est bien loin du hacking / piratage informatique tel qu’on l’entend classiquement, et dont le jeu consiste à casser ou à contourner un système de protection informatique en passant par une faille (un port ouvert, une backdoor ou encore un outil spécialisé).
Décryptage.
Le piratage informatique / hacking est retenu dès que l’auteur des faits sait qu’il existe un système de protection des données informatiques et qu’il persiste quand même dans son action
C’est aussi simple que cela : l’internaute qui s’introduit sur le site extranet d’une personne physique ou morale, même à la suite d’une défaillance technique du système de protection, et sans être à l’origine de cette défaillance, et qui se maintient dans ce système pour y dérober des fichiers alors qu’il a préalablement constaté l’existence d’un contrôle d’accès est auteur d’actes de maintien frauduleux sur un système automatisé de données.
Cela peut paraitre injuste au yeux de certains, puisque c’est l’absence de sécurité informatique (en panne) qui rend les informations, prétendument « volées », en réalité disponibles au public par l’utilisation d’un simple moteur de recherches internet.
Pourtant, il faut distinguer l’accès frauduleux et le maintien frauduleux.
L’accès étant facilité par une panne du système informatique, le délit d’accès frauduleux ne peut pas être retenu, certes… Mais cela ne signifie pas qu’on ne peut pas reprocher à l’auteur des faits un maintien frauduleux s’il sait qu’en principe il faut un identifiant et un mot de passe pour accéder à ces informations. C’est le raisonnement suivi par la Cour de cassation.
Pourtant cette analyse ne résiste pas à la décortication de la fraude informatique, laquelle est nécessaire à la matérialisation du délit, qui à mon sens très mal définie dans cet arrêt, je pense à dessein, pour des raisons politiques : c’est ANSES la victime.
Un internaute complètement noob (newbie) peut donc parfaitement être reconu fraudeur et être condamné pour piratage informatique en utilisant Google
Pas besoin d’être un geek ou un hacker, donc, pour être condamné. C’est la leçon à tirer de cet arrêt de la Cour de cassation qui met fin à un mouvement oscillant de la jurisprudence de certaines Cour d’appel et de précédentes positions de la Cour de cassation qui tantôt acceptaient de manière variable la notion d’introduction frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données (STAD). Depuis 2004, la loi s’est élargi aux notions d’accès et de maintien dans un STAD, certes, mais la Cour de cassation s’engouffre dans une appréciation laconique de la fraude informatique qui permet un tel accès et/ou maintien.
En effet, il convient de rappeler que le texte de l’article 323-1 du Code pénal, mis à jour par la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique dispose que : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende« .
Or, l’arrêt retient que l’auteur des faits déclarait avoir découvert tous ces documents en libre accès après une recherche complexe sur le moteur de recherche Google et qu’il affirmait être arrivé par erreur au coeur de l’extranet de l’ANSES. Ce n’est donc pas par une manoeuvre frauduleuse qu’il s’est retrouvé dans l’arborescence de l’intranet de l’ANSES… mais par inadvertance.
Il s’en suit que la notion de « fraude » est au coeur de l’appréciation et que la qualification juridique des faits : l’auteur des faits fraude-t-il lorsqu’il n’utilise aucun outil de piratage, ni aucun savoir-faire illicite de hacking, ni aucune manoeuvre particulière ? Autrement dit, l’auteur des faits fraude-t-il lorsqu’il utilise un moteur de recherche internet avec un navigateur pour récupérer une information (un fichier informatique) rendu disponible publiquement en raison d’un défaillance du système de sécurité ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative en se bornant à souligner que l’auteur s’est maintenu sur l’extranet litigieux « alors qu’il avait constaté l’existence d’un contrôle d’accès« . Il a constaté l’existence d’un contrôle d’accès ne signifie pas qu’il avait conscience que ce contrôle d’accès régissait forcément l’accès aux données litigieuses. Comment le savoir de toute façon, si par définition, ce contrôle d’accès ne fonctionne pas.
C’est critiquable : si je suis mené par Google sur un site extranet non sécurisé (qui lorsqu’il est ouvert a toutes les apparences d’un site internet), comment faire la différence entre ce que j’ai le droit d’y faire ou pas ? La réponse est simple : certains extranets ont des zones d’informations publiques (généralement en lien avec un site internet mais pas obligatoirement) et des zones d’informations privées, protégées par mot de passe. Si la sécurité ne fonctionne pas, je ne ferai donc pas nécessairement la différence.
La Cour de cassation élude admirablement bien la question…. pourtant la réponse à cette question fournit un autre élément : l’élément moral / intentionnel de l’infraction de maintien frauduleux dans un système automatisé de données.
La conscience d’être dans un système informatique protégé : l’élément moral de l’infraction du maintien frauduleux
La Cour de cassation adopte un raisonnement confus dans un « attendu » fouilli mêlant deux délits différents (« maintien frauduleux » – art. 323-1 du Code pénal et « vol » – art. 311-1 du Code pénal).
Sur la question de maintien frauduleux, la seule conscience d’être dans un système informatique protégé suffit à caractériser l’élément matériel. Dont acte : le délit de maintien frauduleux est un délit matériel avec un élément matériel extrêmement fugace. Il fallait que ce soit dit. Je ne suis pas d’accord, mais on le saura pour la prochaine fois.
Sur l’autre incrimination retenue, on notera que ce n’est pas le délit « d’extraction, de détention, de reproduction, de transmission, de suppression ou de modification frauduleuse des données » de l’article 323-3 du Code pénal qui a été instruit et poursuivi dans cette affaire… mais le délit de « vol » de l’article 311-1 du Code pénal.
La Cour de cassation aurait donc dû écarter cette incrimination de vol comme n’étant pas applicable au délit informatique de téléchargement illicite de fichiers et données.
Cela semble ne choquer personne et pourtant cela devrait. En appliquant l’incrimination pénale de « vol » à un délit informatique « d’extraction et de reproduction de données informatique », la Cour de cassation méconnaît le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Si le législateur a créé l’article 323-3 du Code pénal, ce n’est pas pour faire joli. C’est parce qu’il n’y a pas de vol – autrement dit pas de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui – lorsqu’on télécharge un fichier informatique. Le délit n’est matériellement pas constitué, car il s’agit d’une simple reproduction, pas d’une soustraction de la chose d’autrui.
Pourtant c’est bien en s’appuyant sur le prétendu « vol » commis que la Cour de cassation va retenir la responsabilité du dangereux prévenu, comme signe de la volonté de nuire de l’auteur des faits. Etrange que de s’appuyer sur un délit de vol non constitué pour asseoir une décision de maintien frauduleux dans un système automatisé de données.
La préparation du délit motivé par un mobile dérisoire, gage de la volonté de nuire ?
Il est vrai cependant que l’auteur des faits était caché derrière un VPN panaméen lors de sa recherche internet complexe sur Google laquelle l’a mené à l’extranet litigieux et aux données informatiques litigieuses. Je reconnais volontiers que c’est suspect, comme attitude, et qu’on est peut être pas face à un internaute classique qui utilise son adresse IP française de son fournisseur d’accès français.
D’un autre côté l’utilisation de VPN se démocratise, car un VPN permet notamment de faire des recherches sans être identifié et « profilé » par Google dans les recherches opérées (pourvu qu’on ne se connecte pas à son compte Google évidemment). De là, à en déduire une intention criminelle, il ne faut pas aller trop vite.
Et c’est là que réside la plus surprenante tournure de cet arrêt : pour quel mobile l’auteur se voit-il reproché un maintien frauduleux dans un système automatisé de données et un vol de fichiers informatiques ? Réponse de la Cour de cassation : pour « avoir seulement fait une extraction de 250 mégaoctets qu’il avait utilisés pour argumenter son article sur la légionellose » et pour « avoir communiqué des documents à un autre rédacteur du site ».
Ah, oui ! Ca valait la peine de le condamner celui-là (ironie)… Et de tordre le bras à des incriminations pénales pour les appliquer à la va-vite ? Moins sûr.
Moralité, cet espiègle internaute a été condamné à 3.000,00 € d’amende. Vous me direz « c’est peu » ? Eh bien, non, c’est déjà trop dans un pays où le salaire moyen net mensuel, par ménage, est de 2 410 € nets / mois… surtout lorsque notre plus haute institution judiciaire jongle avec incriminations pénales pour asseoir une décision contestable.
C’est surtout trop au regard de ce que coûte l’ANSES dans les rapports de la Cour des comptes : l’ANSES a certainement les moyens de s’offrir un bon administrateur réseau et du matériel de qualité. Néanmoins, j’ai un peu l’impression que c’est le justiciable qui est placé au sens propre, sur le banc des accusés. Pas l’autorité publique qui a géré sa sécurité informatique de manière discutable.
On aura compris la leçon.

2015

Le coût du droit de suite, qui doit être payé à l’auteur lors de toute revente d’une œuvre d’art par un professionnel, peut tout aussi bien être supporté définitivement par le vendeur que par l’acheteur
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le droit de suite est défini par une directive de l’Union Européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001 et par l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle (en droit français) comme le droit pour l’auteur d’une œuvre d’art originale à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession.
L’article L.122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de suite est à la charge du vendeur et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
Dans le cadre de l’organisation de ventes aux enchères d’œuvres d’art organisée par Christie’s France, certaines de ces ventes donnent lieu à la perception d’un droit de suite. Or, les conditions générales de vente de Christie’s France prévoient que, pour certains lots désignés dans son catalogue, cette dernière perçoit de la part de l’acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, la somme correspondant au droit de suite.
Le Syndicat National des Antiquaires (SNA) estimant que les conditions générales de Christie’s France constituaient un acte de concurrence déloyale en mettant le droit de suite à la charge de l’acheteur a souhaité poursuivre Christie’s France en justice.
Pour sa part,Christie’s France considère que la Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, énonce sans autre précision ou restriction, que le droit de suite est à la charge du vendeur et qu’elle n’exclut donc pas un aménagement conventionnel de la charge du paiement de ce droit.
Saisie de ce litige, la Cour de cassation française demande à la Cour de justice si le vendeur supporte toujours définitivement le coût du droit de suite ou bien s’il est possible de déroger à cette règle par voie conventionnelle.
La CJUE, dans un arrêt C-41/14 « Christie’s France / SNC », répond que si la directive dispose que la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur, elle prévoit néanmoins une dérogation à ce principe et laisse ainsi les États membres libres de définir une autre personne parmi les professionnels visés dans la directive 2001/84.
La personne redevable du droit de suite ainsi désignée par la législation nationale est libre de convenir avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte en définitive, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
En tout état de cause, il convient de bien souligner que Christie’s France avait pris soin de noter que le paiement de la redevance du droit de suite était réglée « au nom et pour le compte du vendeur », instaurant ainsi un mandat afin de paiement, en toute transparence. Il paraît bien évidemment plus prudent de se placer sous la double bannière de cette question préjudicielle à la CJUE et du mandat afin d’être certain de profiter de l’aménagement organisé par la Directive 2001/84/CE.
Enfin, reste à savoir si le législateur profitera d’un nième lifting du CPI pour introduire cette exception au coeur de l’article L.122-8, exception qui semble définitivement acquise.

2014

Le nouveau contrat d’édition et l’édition numérique
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le Code de la propriété intellectuelle vient de nouveau d’être mis à jour, par une Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition dont les contours, la forme et les conditions d’exploitation sont désormais mieux définies et ne relèveront plus de la seule appréciation du juge parfois différente d’une juridiction à l’autre.
Cet ajout législatif consiste notamment à intégrer la notion d’édition d’oeuvres par voie électronique en dessinant les contours de forme et de fond du contrat de cession de droits relatifs à ce type d’exploitation de l’oeuvre. L’ordonnance modifie donc certains des articles déjà existants et rajoute une sous-section 2 au livre I du Code de la propriété intellectuelle, par l’ajout de huit articles L. 132-17-1 à L. 132-17-8 .
1. Le contrat d’édition plus formaliste sur la cession de droit et la rémunération de l’auteur
Le contrat d’édition portant sur un ouvrage littéraire devra déterminer les conditions de la cession sur support papier et sur support numérique (« ebook » ou « livre numérique ») dans des parties distinctes, à peine de nullité de la cession.
Surtout, le nouvel article L. 132-17-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition garantit à l’auteur « une rémunération juste et équitable » sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, et qu’en cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes. Cela renvoie directement au mode de commercialisation de type e-book à l’unité, comme sur la plateforme iTunes par exemple.
Résolument moderne (on pouvait s’y attendre de la part du Pr. Sirinelli), le modèle économique reposant en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre est pris en compte et doit avoir un impact direct sur la rémunération due à l’auteur à ce titre. Ce mode de rémunération est donc clairement autorisé, ce dont certaines sociétés très en avance en la matière, telle Youboox et ses partenaires éditeurs, peuvent se féliciter.
Enfin la rémunération forfaitaire est exclue pour la cession de l’ensemble de ses droits d’exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d’exploitation numérique du livre, sauf dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, tels que mentionnés au 4o de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour une opération déterminée.
De manière non moins importante, l’article L. 132-17-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition doit comporter une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique, sans toutefois qu’une périodicité ou des conditions de déclenchement n’aient été introduites par le législateur… ce qu’on peut regretter car la mise en oeuvre d’une telle clause risque là encore de faire couler de l’encre jurisprudentielle.
2. Des obligations d’exploitation de l’oeuvre et de reddition des comptes renforcées
Le contrôle de la rémunération effective l’auteur et de l’exploitation effective de l’oeuvre sont désormais regardées de plus près en renforçant les obligations de l’éditeur.
Concernant la reddition des comptes, l’éditeur devra désormais procéder à une reddition des comptes au moins une fois par an, à la date prévue au contrat et au plus tard six mois après l’arrêté des comptes qui précède. A défaut, l’auteur disposera d’une faculté de résiliation du contrat, de plein droit.
De plus, concernant l’exploitation de l’oeuvre, l’auteur pourra également remettre en cause le contrat par voie de résiliation si, pendant deux années consécutives suivant les quatre premières années de la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître aucun droit versé ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations de vente sur support papier, vente à l’unité par voie numérique, consultation en ligne ou traduction intégrale.
Toutefois, le II. de l’article L.132-17-4 et l’article L. 132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle disposent qu’un accord entres organisations professionnelles et syndicats d’auteurs pourrait être rendu obligatoire par le Ministre chargé de la culture afin de déroger aux règles fixées par le I. de l’artice L.132-17-4 par la mise en place d’autres modalités concernant cette obligation d’exploitation de l’oeuvre.

2014

Droit des brevets : de la contrefaçon à la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Agir en contrefaçon contre un concurrent en vertu d’un brevet d’invention n’est pas sans risque : le défendeur dans un procès en contrefaçon a la faculté d’invoquer la nullité du brevet, soit pour défaut de nouveauté, soit pour défaut d’activité inventive. Il convient donc, avant d’agir en justice, de prendre soin d’analyser scrupuleusement les forces en présence, le brevet et ses revendications, la date de sa première mise en oeuvre, ainsi que les modes de divulgation du procédé protégé.
De même, un soin particulier doit être apporté aux opérations de saisie-contrefaçon car la nullité des opérations peut anéantir tout le système de preuve nécessaire à la démonstration de la contrefaçon.
Enfin, la conduite du procès en contrefaçon nécessite une certaine prudence pour ne pas voir la procédure se retourner contre soi alors qu’on était demandeur au départ : le fait d’annoncer à des clients ou des prospects qu’un procès en contrefaçon est en cours contre un concurrent est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale par dénigrement.
Dans un jugement rendu le 10 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de se prononcer, une fois n’est pas coutume : sur la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ; sur la nullité d’une saisie contrefaçon pour défaut de signature de la requête par l’avocat de la requérante ; et sur la demande reconventionnelle du défendeur (c’est à dire du prétendu contrefacteur) au titre du dénigrement.
La nullité des opérations de saisie-contrefaçon pour défaut de signature de la requête
Dans cette affaire le Tribunal a retenu que « l’absence de signature de la requête vicie l’ensemble des actes subséquents et le tribunal est compétent pour prononcer la nullité des procès-verbaux des opérations de saisie réalisées (…). »
En effet, les deux requêtes présentées au nom de la société demanderesse n’étaient pas signées : si elles mentionnaient que l’avocat auteur de la requête était l’avocat de la société demanderesse, cette seule mention ne permettaient pas de connaître l’identité et la qualité de la personne ayant effectivement formulé la requête en l’absence de toute signature.
Cette absence de signature de la requête afin de saisie-contrefaçon constitue un vice de fond qui entraîne la nullité de l’acte sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
De plus, le Tribunal vient confirmer qu’en matière de saisie-contrefaçon, les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que le juge du fond appréciant la validité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler des procès-verbaux de saisie pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance, outre le fait que la faculté lui en est expressément réservé parle Code de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon du brevet dont la protection était sollicitée reposant uniquement sur les informations et documents obtenus lors des saisies contrefaçon, ont été rejetées par le Tribunal en l’absence de tout élément de preuve valide.
La nullité du brevet pour défaut de nouveauté
Dans cette affaire le Tribunal constate qu’une notice, datée d’avril 2005, publiée sur le site Internet de la société demanderesse, quoique postérieure au dépôt du brevet effectué en juillet 2003, indique néanmoins que depuis dix ans la technologie protégée par le brevet litigieux dans différents marchés… la société demanderesse expose donc sur son site internet qu’elle exploite la technologie de son brevet depuis plus de 7 ans avant que n’en soit déposée la demande de brevet.
C’est l’exemple type du procédé frappé d’un défaut de nouveauté et rendant le brevet nul.
Il convient en effet de rappeler ici que l’INPI n’effectue pas de contrôle a priori sur la validité et la nouveauté du brevet : cette hypothèse est donc beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense et c’est la raison pour laquelle il est important de toujours examiner le critère de nouveauté d’un brevet de manière approfondie que l’on soit en défense ou que l’on prévoit d’assigner en contrefaçon.
Le Tribunal conclue donc sa découverte ainsi : « Il ressort ainsi de cette notice datée de 2005 que la société [demanderesse] commercialise un procédé de filtrage avec décolmatage automatique des diatomées par injection d’eau et d’air comprimé depuis 10 ans soit depuis 1995. Ainsi cette notice réalisée par la société [demanderesse] constitue une preuve d’une divulgation du procédé objet de l’invention, antérieure au dépôt du brevet. (…) Ainsi la société [demanderesse] ayant divulgué l’invention telle que présentée dans la revendication n°1 avant d’avoir procédé au dépôt du brevet, celle-ci ne présente pas le caractère nouveau requis par la loi et doit être déclarée nulle.«
En voulant se faire sa publicité, la société demanderesse s’est donc tiré une balle dans le pied.
Le défaut de détachement des revendications du brevet et son effet sur la nullité globale du brevet
Dans cette affaire, le Tribunal va logiquement pousser son raisonnement sur la nullité de la revendication n°1 dudit brevet pour en déduire d’éventuels effets sur les autres revendications.
Le Tribunal constatera que, bien que la demanderesse ait invoqué également les revendications dépendantes 2 et 3, 5 à 9 et 11 à 13 de son brevet FR 2 857 833 et que les défenderesses aient sollicité l’annulation du brevet dans son ensemble, il ne s’est pas instauré de discussion sur la validité des revendications dépendantes, c’est à dire que la société demanderesse n’a pas cherché à défendre les autres revendications de son brevet.
Et le Tribunal en a déduit que la nouveauté et l’activité inventive du brevet étaient uniquement incluses dans la revendication n°1 de telle sorte que l’ensemble des revendications, qui portent sur des aménagements secondaires, ont donc été également annulées.
La contre-attaque du défendeur pour concurrence déloyale par dénigrement
Non contente d’assigner son prétendu contrefacteur en justice, la société demanderesse a cru bon d’indiquer aux clients et prospects commun de son concurrent, qu’elle avait assigné ce dernier en contrefaçon en joignant une copie de son assignation à ses correspondances.
Le Tribunal indique que l’assignation qui jointe aux courriers de la demanderesse, présente de manière partiale les faits reprochés à la société défenderesse et en la joignant aux lettres, la société demanderesse a fait perdre à l’information qu’elle délivrait leur caractère pondéré et strictement nécessaire pour manifestement tenter d’influencer la décision des communes sur l’attribution des marchés (“Nous vous laissons en tirer les conséquences”).
Le Tribunal ne retient pas la faute au titre de l’envoi d’un simple mail d’information, mais bien de la fourniture conjointe de l’assignation qui est un document par définition partial. C’est en cela que la communication va être jugée fautive et que sera reconnu un droit à réparation au profit du concurrent.
L’arroseur devient arrosé.

2014

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2013
Tribunal de Grande Instance de Paris Read More
2014

L’Acte d’Avocat : définition et sécurité des transactions
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le CNB explique ce qu’est l’Acte d’Avocat et le type de contrats ou d’accords qu’il permet de sécuriser (rupture du contrat de travail, cession de fonds de commerce, cession de marque, licence de logiciel, cession de droit d’auteurs, vente de site internet, compromis de vente, séquestre, séquestration du prix, séquestration des sources, contrat de confidentialité…)
Acte sous seings privés sécurisé, l’acte d’avocat permet de s’assurer de la qualité des parties et de la validité des clauses contractuelles stipulées au contrat, grâce à l’intervention d’un ou plusieurs avocat(s) rédacteur(s) de l’acte.
Chaque avocat enregistre son client après vérification des éléments d’identité et chaque client signe le contrat par voie électronique : pas de papier, l’Acte d’Avocat est, en outre, écolo !
Voir également notre service d’accompagnement à la cession de sites internet (rédaction du contrat de vente, séquestration du prix, séquestration des sources, enregistrement du contrat).

2014

Contrefaçon de dessins et modèles communautaires : la protection des design enregistrés et non enregistrés en Europe
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de revenir sur les notions de dessins et modèles enregistrés et de dessins et modèles non enregistrés, dans un arrêt n° C‑345/13 du 19 juin 2014 « Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd ».
Dans cet arrêt l’Avocat Général, M. Melchior Wathelet, a pris le soin, dans ses conclusions du 02 avril 2014, de rappeler et d’expliciter le texte du règlement n°6/2002 DU CONSEIL du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
Rappelons à ce titre que le règlement européen dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin oumodèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel, ces critères se définissant ainsi :
- CARACTERE NOUVEAU : un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle dont la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
- CARACTERE INDIVIDUEL : Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle dont la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
La CJUE a suivi les conclusions de son avocat général en concluant que, dans le cadre d’actions en contrefaçon, un dessin ou modèle communautaire non enregistré doit être présumé valide si son titulaire indique dans quelle mesure il présente un caractère individuel.
Toutefois la question portait également sur la question de savoir si l’existence du caractère individuel du dessin ou modèle (ou du design) doit être examinée en référence seulement à un ou plusieurs dessins ou modèles individuels divulgués au public antérieurement, ou s’il doit également être examiné en référence à des combinaisons d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs.
Dans son arrêt du 14 juin 2014, la Cour constate juge que le caractère individuel d’un dessin ou modèle en vue de l’octroi d’une protection au titre du règlement doit être apprécié par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement.
Par conséquent, cette appréciation ne peut pas se faire en référence à une combinaison d’éléments spécifiques et isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs.
En conséquence pour s’assurer de la protection conférée par son dessin ou modèle, même non enregistré, le titulaire de droit doit donc simplement démontrer en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel : c’est-à-dire qu’il doit identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné(s) qui, selon lui, confère(nt) un tel caractère à celui-ci.

2014

Arrêt CJUE dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070fr.pdf Read More
2014

La marque, même tridimensionnelle n’a pas vocation à protéger un design
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Marque ou modèle, il faut choisir. C’est ainsi que l’avocat général Maciej Szpunar auprès de la CJUE a estimé que le droit de l’Union excluait tout enregistrement à titre de marque des formes imposées par la fonction du produit ainsi que les formes dont les caractéristiques esthétiques décident de l’attrait exercé par le produit.
En l’espèce, la société norvégienne Stokke A/S a déposé auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle une demande d’enregistrement pour une marque tridimensionnelle.
Cette marque reprend le dessin en trois dimensions (ou le design ou le modèle, selon l’expression préférée) de la chaise pour enfant « Tripp Trapp ».
De son côté, la société allemande Hauck GmbH & Co. KG produit et distribue des articles pour enfant, dont deux modèles de chaise nommés « Alpha » et « Beta ».
La société Stokke A/S et les deux auteurs personne physique du design industriel introduisent un recours contre la société Hauck, au motif que la vente des chaises « Alpha » et « Beta » viole leurs droits d’auteur ainsi que les droits tirés de la marque enregistrée par la société Stokke A/S.
La société Hauck forme une demande reconventionnelle, afin de l’annulation de la marque. En 2000, une juridiction néerlandaise accueille favorablement le recours des auteurs en ce qui concerne la violation des droits d’auteur tout en annulant, conformément à la demande de la société Hauck, l’enregistrement de la marque de la société Stokke A/S.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le « Hoge Raad der Nederlanden » (Cour suprême des Pays-Bas) pose à la CJUE des questions préjudicielles sur les motifs pour lesquels une marque constituée par la forme du produit peut être frappée de nullité.
C’est dans ce contexte que l’avocat général a estimé que la notion de « forme imposée par la nature même du produit », couvre non seulement les formes naturelles et les formes qui font l’objet de normes (comme par exemple la forme d’une banane pour les bananes ou bien celle d’un ballon de rugby), mais également d’autres formes, à savoir celles dont les caractéristiques essentielles résultent de la fonction du produit concerné. Il s’agirait par exemple, pour une table, de pieds accolés à un plateau horizontal ou, pour une brique, de la forme d’un parallélépipède.
L’avocat général considère également que le droit de l’Union exclut l’enregistrement d’une forme dont l’ensemble des caractéristiques essentielles sont conditionnées par la fonction utilitaire assurée par le produit. Réserver des caractéristiques revêtant une importance essentielle pour la fonction du produit au bénéfice d’un seul opérateur économique ferait obstacle à ce que des entreprises concurrentes attribuent à leurs produits une forme qui serait tout aussi utile à l’utilisation de ces derniers. Le propriétaire de la marque se verrait ainsi octroyer un avantage significatif qui aurait des effets négatifs sur la structure de la concurrence sur le marché concerné.
S’agissant du motif de refus ou de nullité basé sur les « formes qui donnent une valeur substantielle au produit », l’avocat général indique que le champ d’application de ce motif ne se limite pas aux œuvres d’art et aux œuvres des arts appliqués. Il concerne également les produits qui ne sont pas ordinairement perçus comme des objets assurant une fonction ornementale, mais pour lesquels l’aspect esthétique de la forme constitue l’un des éléments essentiels décidant de leur attractivité et joue un rôle important sur un certain segment défini du marché (comme c’est le cas pour les meubles de design). Partant, ce motif s’applique aux formes dont les caractéristiques esthétiques constituent une des raisons principales pour lesquelles le consommateur décide d’acheter le produit. Cette interprétation n’exclut pas que le produit présente d’autres caractéristiques importantes pour le consommateur.
Il semblait en effet utile de rappeler que les objets (les biens) matériels ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt de marque dans le sens où la forme de l’objet pourrait créer au bénéfice du déposant un monopole d’exploitation, ce qui n’est pas souhaitable.
En effet, la superposition du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles (du design autrement dit) protègent déjà suffisamment les objet tridimensionnels faisant l’objet d’une exploitation artisanale ou industrielle.
A ce titre, la logique de l’avocat général n’est pas sans rappeler les analyses faites quant au caractère propre qu’un dessin ou modèle doit conserver afin de conférer une protection efficace à l’objet auquel il se rapporte.
Enfin, les conclusions de l’avocat général doivent également être mises en lumière au regard du fait qu’une marque peut être renouvelée sans limite de temps… alors que le dessin ou modèle est limité à 25 ans d’existence que ce soit un dessin ou modèle français ou un dessin ou modèle européen.
L’aspect temporel du monopole conféré au titulaire de droit n’est donc pas neutre dans l’affaire et il aurait été bon d’y faire directement référence, car c’est aussi cela qui motive, sans nul doute, la position de l’avocat général… position qui, rappelons-le, n’engage pas la CJUE…
Attendons donc la solution.