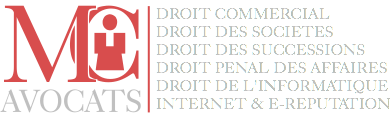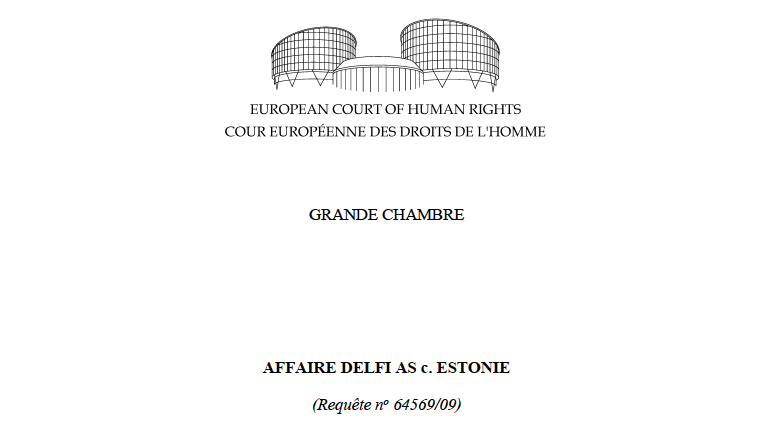2015

La CEDH valide le principe de responsabilité « LCEN » des hébergeurs pour les avis et commentaires d’internautes
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par un arrêt pris en Grande Chambre, en date du 16 juin 2015, a jugé que la loi « SSI » estonienne (loi sur les Services de la Société d’Information) était conforme à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Hommes et des Libertés Fondamentales (CDHLF) sur la liberté d’expression.
Or, la loi « SSI » estonienne, au même titre que la loi « LCEN » française, s’inscrivent dans la droite ligne des directives « SSI » 98/34/CE et « commerce électronique » 200/31/CE, comme le rappelle la Cour Européenne. Ce qui vaut pour la loi estonienne vaut donc pour la loi française.
A ce titre, cet arrêt souligne que les éditeurs de contenus, qui sont aussi hébergeurs de commentaires ou d’avis d’internautes sur ces contenus, ont une responsabilité limitée mais certaine, non seulement quant au prompt retrait des commentaires excessifs dépassant le cadre de la liberté d’expression, et à plus forte raison lorsque ces éditeurs-hébergeurs ne s’assurent pas de moyens réalistes pour tenir les auteurs desdits commentaires / avis responsables de leurs propos.
Pour arriver à cette solution, la Cour souligne bien que la législation estonienne, comme la législation française, met en avant le principe de liberté d’expression et de responsabilité limitée des hébergeurs de contenus, sans aucune obligation de contrôle a priori des informations hébergées.
Principe de liberté d’expression sauvegardé, pas de contrôle a priori, responsabilité limitée des hébergeurs
Dans la législation estonienne, poursuit la Cour dans son analyse, seuls sont susceptibles d’être poursuivies les atteintes à la personnalité, la diffusion d’informations fausses, et la responsabilité pour faute [süü] équivalent de notre article 1382 du Code civil.
Or, c’est exactement le type de législation préconisée par le Conseil de l’Europe dans sa Déclaration sur la liberté de la communication sur l’Internet du 28 mai 2003, texte qui est désormais consacré par l’important arrêt de la CEDH.
En effet, dans la déclaration du 28 mai 2003, le Conseil de l’Europe précise notamment que « Afin d’assurer une protection contre les surveillances en ligne et de favoriser l’expression libre d’informations et d’idées, les États membres devraient respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité. Cela n’empêche pas les États membres de prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux, conformément à la législation nationale, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et aux autres traités internationaux dans le domaine de la justice et de la police« .
Que la CNIL se le tienne pour dit, depuis plus de 12 ans : il ne serait pas illégitime de conserver des données sur les utilisateurs de services en lignes, même à titre gratuit, pour leur identification future de l’auteur d’un éventuel délit ou d’une éventuelle atteinte aux droits d’un tiers. Cela n’est toutefois pas prévu (ou du moins pour une durée bien trop limitée) par le cadre légal sur la conservation des données personnelles, telle qu’encadrée par la CNIL dans ses précieuses déclarations CNIL que nous connaissons tous.
Responsabilité en cas de retrait tardif et de défaut de moyen d’identification de(s) (l’) auteur(s) de l’infraction ou de l’atteinte
Quant au contrôle – a posteriori – après signalement d’un contenu illicite, le Conseil de l’Europe détaille les moyens que peuvent employer les éditeurs de contenus qui hébergent également les commentaires ou avis des internautes sous leurs publications.
Enfin, la Cour rappelle les dispositions de la Directive « Services de la société de l’information » 98/34/CE dans la droite ligne de laquelle se situent les législations estoniennes et française.
En conséquence, l’arrêt relève notamment que l’insuffisance des mesures prises par la société d’édition requérante : 1) pour retirer sans délai après leur publication les propos litigieux ; et 2) pour assurer une possibilité réaliste de tenir les auteurs des commentaires pour responsables de leurs propos ; est susceptible d’engager la responsabilité d’un éditeur-hébergeur sans que ce dernier puisse arguer de la violation par la législation de son pays de l’article 10 de la CDHLF.

2014

Suppression et blocage de contenus sur internet : article 53 de la loi de 1881 (presse) ou article 6 LCEN
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le Tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, vient de rendre un jugement (source : Legalis.net), par lequel il déboute le Procureur de la République, le CRIF, la LICRA et l’ACIT de leur demande tendant à supprimer l’accès à des sites internet à caractère antisémite.
Il est certes important de protéger la liberté d’expression, en soumettant les procédures pénales, ainsi que les procédures civiles, visant à engager la responsabilité des auteurs des messages incriminés au titre d’une infraction de presse à la rigueur procédurale de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Cass. ass. plén., 15 février 2013, n°11-14.637).
Et n’apparaît pas forcément illogique le Conseil constitutionnel se soit prononcé en faveur de l’application du formalisme de l’article 53, y compris à l’assignation en référé : toute procédure doit respecter ce formalisme pour valablement limiter la liberté d’expression…
Cependant, cette affaire laisse un arrière goût amer : l’atteinte à l’ordre public perdure en raison d’un mauvais choix procédural certainement motivé par le soucis, infondé, de respecter inutilement le contradictoire : mon affirmation est sérieuse, le procureur a inutilement respecté le contradictoire en assignant la personne soupçonnée d’être l’auteur des propos incriminés.
Pour rentrer dans le détail de l’affaire présentée sur Legalis.net, la demande introduite par le Procureur, le CRIF, la LICRA et l’ACIT était fondée sur l’article 6.1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite « LCEN » et sur l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’article 6.I.8 de la LCEN 8. permet à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou, à défaut, à tout fournisseur d’accès à internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
L’article 50-1 la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que si des publications à caractère antisémite ou raciste constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt du site internet (service de communication au public en ligne) peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Or, une demande tendant à la « fermeture » d’un site publiant des propos à caractère antisémite entre bien dans le cadre d’une procédure tendant à suspendre les effets d’une publication susceptible de porter atteinte aux droits d’un ou plusieurs individus (en l’occurrence de toute une communauté religieuse).
Et, pour suspendre les effets d’une publication reprise sur un site hébergé à l’étranger et peu coopératif avec les autorités françaises, la seule mesure envisageable consiste à bloquer l’accès aux URL concernées, voire l’accès au site entier, voire au(x) serveur(s)… et cela ressort de la compétence technique des fournisseurs d’accès à internet Darty Telecom, Free, SFR, Bouygues Télécom, Orange et Numéricable… raison pour laquelle on voit ces derniers pris dans la « toile » de cette procédure.
En conséquence, le Procureur de la République semblait, en théorie, parfaitement bien fondé à solliciter que soit ordonné le blocage du site litigieux sur le fondement des articles 6.I.8 de la LCEN et 50-1 de la loi de 1881.
Pourtant, le Conseil constitutionnel, saisi par QPC du 20 février 2013 transmise par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision n°2013-311 QPC du 17 mai 2013, notamment au visa (!) de l’arrêt du 15 février 2013 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, avait estimé qu’il n’y aurait pas de contradiction dans les dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 et les dispositions gouvernant la procédure de référé en ce que leur combinaison permet un « droit à un recours juridictionnel » dans le cadre de « la protection constitutionnelle de la liberté d’expression » et du « le respect des droits de la défense ».
Et c’est de ces deux décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel que le Tribunal de grande instance de Toulouse tire sa solution, laquelle est indiscutablement bien construite au plan procédural, malheureusement pour le Procureur, le CRIF, la LICRA et l’ACIT qui voient la (potentielle) infraction perdurer malgré la gravité des propos tenus. C’est fort dommage et fort dommageable.
En fait, le Procureur a commis une erreur stratégique : l’article 6.I.8 de la LCEN n’exige pas que les auteurs soient attraits à la cause dans le cadre d’un référé afin de blocage de site internet.
Mais dès lors que le Procureur a fait le choix d’assigner en référé la personne faisant l’objet des poursuites au titre de l’infraction de presse, en plus des fournisseurs d’accès à internet (FAI), il s’est – malgré lui – contraint à devoir respecter le formalisme de l’article 53 de la loi de la presse lequel n’est exigé qu’au bénéfice de la personne poursuivie.
Toutefois, le dispositif de la LCEN permettait au Procureur de ne pas mettre dans la cause la/les personne(s) soupçonnée(s) d’être l(es) auteur(s) des publications incriminées : il pouvait se contenter d’assigner les FAI.
Il convient en effet de rappeler que le dispositif, certes incomplet, de la LCEN de 2004 est de faire face à la spécificité de l’internet afin de permettre, y compris sur requête, l’effacement de contenus publiés par des tiers non identifiés : en effet, sur internet, n’importe qui publie n’importe quoi, en tout anonymat (enfin cela est relatif), et la publication n’a pas de limite de durée ; à l’inverse une parution périodique papier a vocation à l’oubli, il y a une responsabilité en cascade et un directeur de publication aisément identifiable.
Or, en l’espèce, l’affaire en était à l’instruction signifiant par définition l’incertitude d’un lien entre les propos incriminés et la personnes poursuivie objet de l’instruction : on tombe dès lors très précisément dans le cadre de la LCEN ; malgré un soupçon quant à l’identité l’auteur, on agit sur le fondement de la LCEN pour faire effacer ou bloquer les contenus litigieux, sans mettre dans la cause la personne soupçonnée.
Le fait de ne pas avoir à poursuivre l’auteur soupçonné est le contrepoids de la spécificité de l’internet.
La LCEN a donc vocation à faciliter la procédure d’effacement ou de blocage des contenus publiés sur internet pour faire, sous réserve que l’on assigne pas l’auteur soupçonné.
En conséquence, face aux fournisseurs d’accès, pour bloquer le site, sans avoir à respecter l’article 53 de la loi de 1881 le Procureur aurait pu ne pas assigner le (pas encore) prévenu.
Il en est de même, face aux hébergeurs, en matière de nettoyage de e-reputation par voie d’ordonnance sur requête : le respect de l’article 53 ne s’impose pas… cependant, même dans cette matière, il convient de rappeler qu’il convient de motiver les motifs de faits et de droit sur le fondement desquels une mesure de suppression de contenu est sollicitée.
L’exercice en matière de requête afin d’ordonnance n’est pas formel comme dans le cadre de l’application de la procédure du droit de la presse, mais l’idée selon laquelle la motivation en fait et en droit doit être présente et cohérente demeure, afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression.

2014

Diffamation envers un élu : contrôle de la liberté d’expression dans la critique politique
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 08 avril 2014, la Cour de cassation a pu juger qu’une vive critique, qui s’inscrit dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune.
Dans cette affaire, le propriétaire d’une parcelle voisine d’un centre de loisirs et d’une école de pilotage automobile, mécontent de ne pas obtenir l’intervention des autorités municipales pour tenter de mettre un terme aux nuisances sonores qu’il subit, placarde sur une vitre de son véhicule une affichette sur laquelle il avait écrit : « Juin 2010, conseil municipal, Madame le maire, déclare qu’elle ne fera pas appliquer les lois contre les nuisances sonores et si elle le fait ce sera sur tout le village, et cela aura des répercussions économiques. Levier sur le forgeron... ».
Le Maire de cette commune fait citer ledit propriétaire devant le Tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public, mais Tribunal relaxe le propriétaire.
Sur appel interjeté par Madame le Maire, la Cour d’appel de Nîmes réforme le jugement entrepris, et dit la diffamation caractérisée en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs que :
- elle n’aurait pas à tenir compte des circonstances extrinsèques à l’écrit incriminé dont il résultait que le sujet d’intérêt général traité autorisait les propos et les imputations litigieux ;
- la bonne foi du propriétaire ne peut être retenue en raison du caractère erroné des imputations de l’écrit litigieux dont la preuve de la vérité n’a pu être faite ;
En effet, dans cette affaire, l’élue municipale insistait sur le fait que vivre dans une commune touristique avait des avantages et des inconvénients et que la phrase exacte prononcée était : « s’il faut prendre un arrêté, il sera pris sur toute la commune » mais qu’à aucun moment, elle n’a déclaré qu’elle ne ferait pas appliquer les lois sur les nuisances sonores mais qu’elle a seulement expliqué pour quelle raison elle ne prenait pas d’arrêté municipal sur le cas précis dénoncé par le propriétaire mécontent.
En fondant sa réponse sur l’article 10 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
La Cour doit se penche ainsi sur droit le plus fondamental des citoyens de critiquer leurs élus qui est en cause et elle rappelle à cet égard que le caractère impérieux de la liberté d’expression ne doit être limité que pour des motifs encore plus impérieux (sécurité nationale, santé, morale, sûreté publique, droits d’autrui, confidentialité, autorité et impartialité de la justice).
La Cour d’appel n’ayant pas constaté une atteinte aux droits de l’élue municipale, la Cour de cassation décide que le propos incriminé, s’inscrivant dans la suite d’un débat d’intérêt général relatif à la politique municipale, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune.
Nous voilà rassurés sur notre liberté d’expression contre un maire, élu d’une commune rurale et touristique.
On notera à ce titre que la Cour de cassation a pris soin de souligner avec précision le caractère à la fois rural et touristique de la commune en question. Cela permet de mettre en exergue la contrariété des intérêts en présence et la justification de ce que les administrés, estimant subir des désagréments d’une politique privilégiant – par décision d’opportunité politique – l’un de ces intérêts plutôt que l’autre, puissent s’exprimer librement.
Le fait est que le texte incriminé est critique et même s’il est imprécis quant à la nature des propos tenue par l’élue de cette commune (impliquant le caractère matériellement inexact de l’imputation), ils traduisent bien l’incompréhension d’un administré, sans toutefois que ce message ne porte atteinte à l’honneur de Madame le Maire, contrairement à ce qu’elle a pu soutenir dans ses conclusions d’appel.

2014

le propos incriminé, qui s’inscrivait dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en oeuvre de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l’environnement, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune
Arrêt n° 1356 du 8 avril 2014 (12-88.095) - Cour de cassation - Chambre criminelle Read More
2013

Dénigrement par voie de presse et sur internet : la e-reputation en droit des affaires
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Peut-on tout écrire au titre de la liberté d’expression sur un concurrent ou un ex-partenaire commercial sans nuire à sa eReputation ? Quel est la limite à ne pas franchir pour ne pas tomber dans un abus de liberté d’expression ? Enfin, en matière de e-réputation, quels sont les critères permettant de distinguer diffamation et dénigrement ?
Voilà autant de questions auxquelles la Cour de cassation s’attache à répondre en ce moment.
Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé que toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par la non-conformité d’un produit aux normes françaises ou européennes, est susceptible de constituer un dénigrement (voir notre article du 10 octobre 2013 dernier, à ce sujet).
Cette fois, par un arrêt n° 1354 du 27 novembre 2013 (12-13.897), la Première chambre civile de la Cour de cassation vient apporter un éclairage supplémentaire quant à la notion de dénigrement et les conséquences du dénigrement entre professionnels.
Rappel des faits :
Un agent général d’une société d’assurance manifeste son intention de démissionner de ses fonctions pour transmettre l’exercice de ses mandats à ses deux fils, qu’il employait comme collaborateurs.
La société d’assurance mandante refuse d’agréer la candidature de ses enfants, confie la gestion des portefeuilles à d’autres intermédiaires et elle interrompt les connexions informatiques de l’agent général.
Ce dernier dénonce la situation au moyen d’un “blog”, d’affiches ou d’articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle.
Déplorant la publicité négative faite à sa e-réputation, la société d’assurance lui notifie sa révocation avec effet immédiat.
Position de la Cour de cassation :
Rejetant le premier moyen de l’agent général sur la cause de la révocation du mandat d’agence, la Cour de cassation retient que si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances.
Il est vrai que l’agent général n’a pas hésité, dans cette affaire, à conduire une partie de la clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats pour en souscrire d’autres auprès d’entreprises d’assurances concurrentes, par l’intermédiaire du cabinet de courtage géré par son épouse.
Dans ces conditions, la Cour ne pouvait faire autrement que de reconnaitre le dénigrement et les actes de concurrence déloyale.
Mais cet arrêt rappelle également une nouvelle distinction quant à l’action menée en matière de concurrence déloyale et dénigrement, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et l’action en diffamation, fondée, quant elle, sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, la Cour d’appel de Besançon avait relevé que les propos dénigrant l’activité de la société d’assurances avaient jeté le discrédit sur ses produits et services, en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d’expression.
Cependant, la Cour d’appel avait cru bon de rejeter les demandes de la société d’assurance en soulignant que les abus de la liberté d’expression commis par voie de presse ne relèveraient pas de la responsabilité civile de droit commun et ne pourraient pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, mais sur le fondement de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881.
La Cour de cassation vient sanctionner le raisonnement de la Cour d’appel en soulignant que le dénigrement (Art. 1382 du code civil) a vocation à s’appliquer par exception à la diffamation (art. 29 L. 29 juillet 1881), dès lors que propos litigieux avaient pour effet ou pour objet de jeter le discrédit sur les produits et service d’un concurrent en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner.
Ce nouvel arrêt a donc le mérite d’illustrer parfaitement comment définir les contours du dénigrement, en s’affranchissant des règles applicables à la diffamation entre professionnels, dès lors que la publication litigieuse a vocation à détourner la clientèle d’un concurrent ou d’une partenaire.
Par conséquent, dans le cas du dénigrement, l’article 1382 du Code civil s’applique dès lors qu’il y a atteinte à la réputation d’une entreprise par la critique de ses produits ou services (que la critique soit avérée ou infondée) créant ainsi une ambiance de concurrence délétère afin de captation de clientèle.
En revanche, la diffamation porte sur la seule atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne morale et physique, par la publication de propos faisant état de faits matériellement inexacts, et sans qu’il soit nécessaire de poursuivre un but de captation ou de détournement de clientèle.
En d’autres termes, si les propos litigieux sont publiés dans un but de concurrence déloyale et donc de dénigrement, l’entreprise victime de tels agissements peut agir sur le fondement de 1382 du Code civil et s’affranchir notamment du délai de prescription court applicable aux infractions de presse (3 mois à compter du jour de première publication).
A défaut de preuve de la poursuite d’objectifs de concurrence déloyale, les propos relèvent alors de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881, à savoir de la diffamation ou de l’injure.